Le contexte
La disgrâce de Portalis s’inscrit dans le conflit entre l’Empereur et le pape, à son paroxysme depuis l’occupation de Rome (2 février 1808), l’excommunication de Napoléon (10 juin 1809) et l’arrestation du Saint Père et son placement en résidence surveillée à Savone (7 juillet 1809). Pie VII pratiquait depuis ce qu’on a appelé « la grève des investitures » des évêques nommés par le gouvernement français, en application du Concordat. Pour s’en sortir, Napoléon entendait ranimer et même dépasser une procédure autrefois employée par Louis XIV dans son conflit avec Innocent XI : 1°) le chapitre de chaque diocèse pouvait confier l’administration de la circonscription à des évêques seulement nommés, qui devenaient « vicaires capitulaires » ou, si l’on préfère un terme actuel, « administrateurs provisoires » ; 2°) l’empereur avait unilatéralement décidé qu’ils adopteraient « le titre de leur siège dans tous leurs actes » sans qu’il soit besoin que leur nomination soit confirmée par le chef de l’Église [5].
La nomination du cardinal Maury à l’archevêché de Paris
Même en étirant à leur maximum les principes gallicans, cette procédure était contraire au droit canon. On pouvait s’attendre à des résistances dans le clergé, et c’est ce qui se passa. Dans les premiers diocèses concernés, on bouda les évêques nommés, ce à quoi le gouvernement répondit par des arrestations d’ecclésiastiques au sein des chapitres ou dans les paroisses les plus récalcitrantes. Il pouvait affronter sans trop de dommages ce type de crises dans des villes secondaires comme Liège, Malines ou Florence, où il se trouvait toujours suffisamment de prêtres pour poursuivre leurs activités sans trop éveiller l’attention des fidèles.
Tel n’était pas le cas à Paris, capitale de l’Europe napoléonienne. L’archevêché y était vacant depuis le décès, à près de 100 ans, de Mgr de Belloy, le 10 juin 1808. Le chapitre avait accepté l’installation d’un vicaire capitulaire, l’abbé d’Astros, en attendant la nomination d’un nouvel archevêque. Napoléon avait d’abord pensé pour ce siège essentiel à son oncle, le cardinal Fesch. Mais celui-ci avait soumis son acceptation à la possibilité de cumuler les archevêchés de Paris et Lyon (où il avait été régulièrement nommé et investi en juillet 1802), tout en conservant ses fonctions de coadjuteur du Prince-Primat de la Confédération du Rhin et de grand aumônier de l’Empire. Même pour un parent aussi proche, qui plus est ecclésiastique respecté, l’empereur ne pouvait pas accéder à des exigences aussi incongrues qui fleuraient l’échappatoire. Et lorsqu’écartant ses conditions, il tenta de forcer l’acceptation de Fesch, il se heurta à un refus formel de sa part. C’est alors qu’un candidat eut la bonne idée de faire savoir qu’il ne refuserait pas de suppléer le « cardinal-oncle » : Jean-Siffrein Maury.

Ce fils de cordonnier, né au tournant du XVIIIe siècle, avait été ordonné prêtre en 1769. Ses talents oratoires lui avaient permis de se hisser jusqu’à la fonction de prédicateur du roi. Membre de l’Académie française en 1785, député du clergé aux États généraux, il avait quitté la France à la fin de la Constituante. Pie VI l’avait nommé archevêque in partibus de Nicée, puis, en 1794, cardinal et évêque de Montefiascone, dans l’archevêché de Rome. Il s’y était longtemps comporté comme un ambassadeur officieux du comte de Provence. Son ralliement à l’Empire, en août 1804, avait été une surprise de taille [6], en même temps qu’une victoire politique pour Napoléon qui l’invita à revenir à Paris, le nomma aumônier de son frère Jérôme et lui rendit son fauteuil à la classe de Langue et Littératures françaises de l’Institut.
Cet homme ambitieux ne plaisait pas à tout le monde. Mme de Boigne disait de lui que « son ton, son langage [auraient] choqué dans un caporal d’infanterie » [7] et la duchesse d’Abrantès trouvait sa « figure désagréable au plus haut point » [8]. Comme on peut s’en douter, son revirement fut surtout fort peu goûté par le Sacré Collège serré autour d’un pape qui résistait avec ses moyens aux empiètements impériaux. On fut à la fois inquiet et peu surpris que Maury accepte sa nomination à l’archevêché de Paris, décrétée par Napoléon le 14 octobre 1810.
Les brefs du pape
Le 1er novembre, le chapitre de Notre-Dame reconnut le cardinal Maury, mais seulement comme vicaire capitulaire de l’archevêché de Paris, en attendant l’investiture du pape. Le vote avait été obtenu à la majorité simple, ce qui n’était pas bon signe. Conformément à ce que souhaitait Napoléon, l’intéressé ne se contenta pas de ce titre intermédiaire et se considéra sur-le-champ pleinement archevêque. Il écrivit à Pie VII pour l’informer de sa bonne fortune et organisa son entrée solennelle à Notre-Dame, entouré d’une procession où figuraient le Clergé parisien et ceux qu’il désignait comme « ses » grands vicaires. Il pensait pouvoir jouer sur tous les tableaux, déclarant, aux chanoines de Notre-Dame, qu’il était entièrement soumis au Saint-Père et, au gouvernement, qu’il lui était dévoué. Les premiers commençaient à gronder et firent plusieurs fois remarquer à Maury qu’il n’était à leurs yeux que vicaire capitulaire. Le second se réjouit de le voir appliquer sans hésiter la procédure imposée par l’empereur.
Il est peu de dire qu’à Savone, Pie VII fut désolé de la tournure des événements et piqué par le ton de la lettre que Maury lui avait adressé. Devant le préfet du département du Montenotte, Chabrol de Volvic, et le général Berthier, qui assuraient sa surveillance, le pape se contenta d’abord de regretter qu’on mette à Paris « la charrue avant les bœuf ». Mais dans une affaire de cette importance, il ne pouvait se contenter de ce propos d’audience. Après quelques jours de réflexion, le 5 novembre 1810, il signa sa réponse à Maury par laquelle il lui interdisait, en termes vifs, d’accepter sa nomination :
« Nous n’aurions jamais cru que vous eussiez pu recevoir la nomination […] et que votre joie, en nous l’annonçant, fût telle que c’était pour vous la chose la plus agréable et la plus conforme à nos vœux ! Est-ce donc ainsi qu’après avoir si courageusement et si éloquemment plaidé la cause de l’Église catholique dans les temps les plus orageux de la Révolution française, vous abandonnez cette même Église, aujourd’hui que vous êtes comblé de ses dignités et de ses bienfaits, et lié si étroitement à elle par la religion du serment ? […] Qui vous a dégagé du lien spirituel qui vous unit à l’église de Montefiascone ? Qui vous a donné des dispenses pour être élu par un chapitre et vous charger de l’administration d’un autre diocèse ? Quittez donc sur le champ cette administration ! Non seulement nous vous l’ordonnons, mais nous vous en prions, nous vous en conjurons, pressé par la charité paternelle que nous avons pour vous, afin que nous ne soyons pas forcé de procéder, malgré nous et avec le plus grand regret, conformément aux statuts des saints canons » [9].
Cette lettre fut interceptée par la police et Maury ne la reçut pas. Qu’à cela ne tienne, une seconde missive de la même eau, datée du 18 décembre, prit le chemin de Paris. Le pape avait pris cette fois la précaution d’en faire établir des copies qui furent remises à divers destinataires. Parmi ceux-ci figurait l’abbé d’Astros, redevenu vicaire général de l’archevêché de Paris.
L’affaire Portalis
L’entrée en scène de l’abbé d’Astros
Né le 15 octobre 1772, Paul Thérèse David d’Astros était le fils de Jean-François Louis d’Astros (1731-1789), notaire à Tourves (Var) et avocat au Parlement de Paris, et de Marguerite Madeleine Angélique Claire Portalis (1739-1792), sœur aînée de Jean-Étienne. À la mort de ses parents, au début de la Révolution, ce dernier avait pris soin de lui, le considérant comme son fils et terminant son éducation au sein de sa propre famille. Le jeune d’Astros avait depuis maintenu des liens amicaux avec son cousin Joseph-Marie, de six ans son cadet.
Ordonné prêtre en 1797, il avait intégré le clergé parisien et notamment le séminaire de Saint-Sulpice, haut-lieu du gallicanisme animé alors par le fameux abbé Emery. En 1801, il était devenu secrétaire de son oncle à la direction des Cultes, aux côtés de son cousin qui y faisait office de chef de cabinet. D’Astros s’y était occupé des nominations épiscopales prévues par le Concordat avant de participer à la rédaction du nouveau catéchisme, achevé en septembre 1803 et qui deviendra ce qu’on appelle le « catéchisme impérial » après quelques ajouts postérieurs. Dès lors, il fut considéré comme un des principaux « docteurs officiels de l’Église de France » [10].
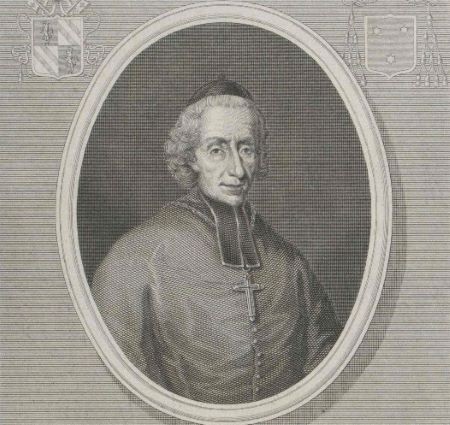
Protégé par le ministre des Cultes, il était devenu chanoine de Notre-Dame puis vicaire général du diocèse en 1805. À la mort du cardinal de Belloy, il avait été élu vicaire capitulaire, fonction qu’il abandonna à la nomination de Maury [11]. Agacé par les manières de son nouvel archevêque, il tenta en vain de le convaincre qu’il ne devait pas se faire installer avant son investiture canonique. Et comme il n’était pas entendu, il demanda secrètement des instructions à Savone. C’est ainsi qu’il fut un des destinataires du bref pontifical du 18 décembre, avec pour mission de le faire connaître à Maury et, si celui-ci ne revenait pas à la raison, au chapitre de Notre-Dame.
La faute de Portalis
L’abbé d’Astros informa discrètement Joseph-Marie Portalis de la situation, lui montrant même les documents qui étaient en sa possession. Le directeur de la Librairie commit alors l’erreur de ne pas tenter de le dissuader d’aller plus loin et de ne pas jouer franc-jeu avec le gouvernement. Voulant protéger son cousin, il se contenta de parler au préfet de Police Pasquier, son collègue et ami du Conseil d’État, de l’existence d’un bref du pape contre Maury, sans donner sa source et sans dire qu’il avait lui-même vu la pièce. Pasquier rendit compte de cette conversation à son supérieur hiérarchique, le ministre de la Police Savary. Celui-ci flairait déjà qu’il se tramait quelque chose à Savone. Il sut désormais qu’un second bref circulait dans Paris [12]. Ses limiers interceptèrent bientôt un nouveau courrier du pape à d’Astros. L’abbé était démasqué.
Informé des progrès de l’enquête aussi bien par Savary que par un rapport du ministre des Cultes, Bigot de Préameneu, Napoléon prescrivit que l’on resserre la surveillance du pape, qu’on envoie à Paris l’évêque de Savone, qu’on arrête plusieurs autres prêtres et, dans l’ensemble, que l’on garde la plus grande discrétion sur ce qu’on savait [13]. Peut-être chargea-t-il alors Cambacérès de prévenir Portalis du soupçon qui commençait à peser sur lui et de lui donner une chance de s’en sortir en dénonçant officiellement les menées de son cousin. L’archichancelier écrit en effet dans ses Mémoires qu’il rencontra le directeur de la Librairie, probablement à la fin décembre 1811. Il lui laissa entendre qu’il n’était pas trop tard pour se mettre en règle vis-à-vis de son souverain. Il regrette de ne pas avoir été entendu et estime que son interlocuteur se fût évité bien des désagréments si « à l’exemple de son père, il se fût aidé de [ses] avis, ou s’il avait eu la franchise de [lui] avouer ses fautes » [14]. Du point de vue du gouvernement, Portalis avait failli en n’avouant pas les menées du grand vicaire de Paris qui pouvaient déboucher sur une crise majeure.
L’arrestation de l’abbé d’Astros
Le 1er janvier 1811, Maury, son vicaire général et les chanoines de Notre-Dame vinrent aux Tuileries présenter leurs vœux à l’empereur. Celui-ci saisit cette occasion pour leur révéler qu’il savait tout des menées de certains d’entre eux. À un moment, il mit même la main à l’épée pour les menacer de s’en servir contre les ennemis de l’église gallicane. À l’issue de l’audience, Maury demanda à d’Astros de l’accompagner au ministère de la Police où le général Savary voulait lui poser quelques questions. À peine arrivé à l’hôtel de Juigné (qui se trouvait de l’autre côté de la Seine par rapport aux Tuileries), le grand vicaire fut mis en état d’arrestation, tandis que des policiers perquisitionnaient son logement de l’archevêché. Entre autres papiers compromettants, on y découvrit une copie du bref du 18 décembre cachée dans un chapeau.

Lors de l’interrogatoire qui suivit, d’Astros reconnut sans difficulté l’avoir montrée à deux autres prêtres et à son cousin Portalis [15]. Le grand vicaire fut sur-le-champ conduit au château de Vincennes où il sera détenu jusqu’en avril 1814 [16]. Sans attendre, tous ceux qui avaient eu des rapports avec lui furent à leur tour arrêtés, coup de semonce qui fit rentrer les ecclésiastiques dans le rang : quelques jours plus tard, en effet, entourant Maury lors d’une nouvelle audience solennelle, les membres du chapitre annonceront à Napoléon qu’ils retiraient ses pouvoirs à d’Astros et reconnaissaient leur archevêque qui, pour marquer l’événement, offrit un grand dîner [17].
La séance du 4 janvier 1811
Cambacérès nous dit encore dans ses Mémoires que l’empereur était « vivement offensé de la conduite tenue par les deux hommes [d’Astros et Portalis] qu’il avait honorés d’une protection particulière, et dont l’un des deux était comblé de ses bienfaits » [18]. Le cas d’Astros était réglé. Restait à s’occuper de Portalis, haut fonctionnaire qui, par son silence, avait couvert les activités d’un conspirateur. C’est ici que se place la séance du Conseil d’État du 4 janvier 1811.
Sur la disgrâce de Portalis, on dispose de plusieurs témoignages directs (Pasquier, Broglie, Rambuteau, Las Cases et… Napoléon lui-même) et du procès-verbal établi par Locré. Commençons par ce dernier, rédigé comme le faisait toujours le secrétaire dans un « style mesuré, grave, froid et uniforme » [19] :
« S. M. demande à M. Portalis s’il a eu connaissance d’une lettre incendiaire émanée du pape et trouvée dans les papiers du sieur d’Astros, l’un des grands vicaires de Paris. M. le comte Portalis dit qu’il la connaît. S. M. demande pourquoi M. Portalis ne l’a pas informé de ce fait. M. le comte Portalis répond qu’il en a informé M. le préfet de Police. M. le baron Pasquier répond qu’en effet, M. Portalis lui en a fait part il y a environ un mois. S. M. dit que l’affaire était d’un telle nature que M. Portalis devait l’en informer Elle-même, soit directement, soit par le canal du Prince archichancelier, que M. Portalis approche, ou par celui du ministre de la Police. Il a au contraire gardé le silence jusqu’au moment où la lettre a été connue et où l’on a eu la preuve qu’il ne pouvait en avoir ignoré l’existence. Alors seulement il en a parlé au ministre de la Police. Ce silence, coupable dans le moindre citoyen, l’est encore plus dans un conseiller d’État. Il l’est surtout dans M. Portalis qui doit à S. M. plus de reconnaissance qu’aucun membre du Conseil.
Elle l’a élevé à la dignité de conseiller d’État, en considération de son père, et avant que son âge et ses services personnels pussent lui permettre d’y aspirer ; elle l’a nommé directeur de l’imprimerie, place d’une haute confiance, parce qu’Elle donne à celui qui occupe, pour ainsi dire le portefeuille de la pensée. Et cependant, c’est celui qui est préposé pour arrêter les écrits dangereux, voit de sang-froid circuler le plus dangereux de tous. Quel peut être le principe d’une telle conduite ? Est-ce l’attachement à la religion ? Il n’est pas possible que M. Portalis entende assez peu la religion pour ne pas savoir qu’elle n’autorise pas les entreprises des papes, qu’au contraire leurs excès la blessent et la déshonorent ; qu’elle ordonne aux peuples d’être fidèles à leur prince et d’obéir aux lois de l’État. Il y a là que cet esprit de parti qui vient de se manifester également en Italie [20]. Heureusement, et S. M. le dit à la gloire de la nation, depuis onze ans qu’Elle gouverne, voilà le premier exemple d’une trahison. Elle a appelé les prêtres déportés ; Elle a fait rentrer les émigrés, jusqu’à ceux qui avaient porté les armes contre Elle ; Elle les a approchés de sa personne, et jamais, et même lorsque la conspiration de Georges [21], aucun Français n’a cessé de lui être fidèle. Si une infidélité semblable à celle de M. Portalis pouvait se reproduire, S. M. serait réduite à n’avoir plus confiance en personne. S. M. ordonne à M. Portalis de sortir à l’instant du Conseil, et, dans le jour, de Paris. M. Le comte Portalis se retire. S. M. charge le secrétaire du Conseil d’insérer au procès-verbal ce qu’Elle a dit et l’ordre qu’Elle vient de donner » [22].

Qu’en termes administrativement élégants ces choses-là furent portées au procès-verbal. Selon Pasquier, témoin mais aussi acteur, la scène dura plus d’un quart d’heure, devant des conseillers d’État estomaqués par le ton et le fond des propos de l’empereur :
« Ayant commencé par s’informer si M. Portalis était là, l’Empereur aussitôt lui demanda, dans les termes de la plus rude apostrophe : « Comment il osait se présenter dans cette enceinte, après la trahison dont il était coupable ». Puis, détaillant cette trahison qui consistait à avoir su et favorisé une correspondance rebelle avec le Pape, avec un souverain étranger, il déclara que « jamais plus indigne perfidie ne s’était vue, qu’il n’en avait dans le cours de sa vie éprouvée aucune dont il ne se fût plus révolté, et cette perfidie partait d’un homme auquel il avait accordé une confiance particulière. Les paroles lui manquaient pour exprimer son indignation ». Ce que je rends ici en dix lignes fut, dans sa bouche, la matière d’une philippique qui dura plus d’un quart d’heures. À mesure qu’il avançait, le son de sa voix, son geste, sa physionomie prenaient un caractère plus effrayant, et, quand il eut fini, tout le monde resta muet d’épouvante. M. Portalis, accablé et comme anéanti, ne fut en état de balbutier que quelques paroles dans lesquelles il exprima la conviction de n’avoir manqué à aucun de ses devoirs, en ne trahissant pas un parent, un camarade d’enfance, qu’il s’était efforcé en même temps de retenir dans la voie dangereuse où il le voyait engagé » [23].
Venons-en au témoignage de Las Cases, alors maître des requêtes :
L’empereur a commencé par l’interroger devant ses collègues : « Quel a pu être votre motif ? […] Parlez, vous êtes ici en famille, vos collègues jugeront ». Et comme Portalis balbutiait qu’il ne pouvait pas dénoncer un cousin, la colère de l’empereur éclata, avec pour finir : « Les devoirs d’un conseiller d’État envers moi sont immenses. Vous les avez violés. Vous ne l’êtes plus. Sortez et ne reparaissez plus ici ! ». Une fois Portalis sorti, Napoléon s’adresse aux autres conseillers : « J’espère, Messieurs, qu’une pareille scène ne se renouvellera jamais, elle m’a fait trop de mal. Depuis que je suis au gouvernement, voilà le premier individu qui m’ait trahi ». puis, se tournant vers le secrétaire général Locré qui prenait des notes : « Trahi, vous entendez, Locré, vous écrirez : trahi » [24].
On a vu plus haut que Locré remplaça « trahison » par « infidélité ». Portalis sortit de la salle en oubliant une partie de ses papiers et son chapeau. Anéanti par la scène qu’il venait de subir, il passa devant l’Empereur qui lui aurait encore dit, en le fixant : « J’en suis navré, Monsieur, j’ai présente la mémoire de votre père ». Le Conseil était abasourdi. Après quelques instants, Napoléon reprit la parole pour dire « le chagrin » qu’il avait éprouvé devant ce qu’il ne renoncerait pas à appeler une « trahison ». Les témoins et, plus tard, Thiers qui en rencontra quelques-uns, attestent que les conseillers étaient si choqués que les remarques de l’empereur furent accueillies avec la plus grande froideur. Le lendemain, Cambacérès déclara qu’il était encore « malade » de ce qu’il avait vu et entendu [25].
Les suites du renvoi
Rentré chez lui, Portalis écrivit sur le champ une lettre éplorée à l’empereur :
« J’ai cru pouvoir prévenir le mal que la circulation d’un tel bref pouvait entraîner en avertissant M. le préfet de Police de son existence. Je n’ai pas nommé l’abbé d’Astros, et c’est en l’avouant que j’embrasse les genoux sacrés de V. M. ; mais je ne voyais à redouter que la publicité du bref ; je ne prévoyais rien au-delà ; je croyais avoir fait tout ce qu’il fallait pour l’empêcher et mon cœur se refusait à accuser un parent, l’ancien ami de mon enfance » [26].
Il était trop tard pour se justifier, ce que Portalis n’avait pas voulu faire avant que l’affaire éclate. Malgré d’ultimes interventions, notamment celle de Regnaud de Saint-Jean d’Angély, président de la section de l’Intérieur, Napoléon avait décidé que le coupable devait quitter Paris et vivre à plus de quarante lieues de la capitale [27]. La décision lui fut notifiée par Pasquier. Toutes ses fonctions lui furent progressivement retirées. Dès le 11 janvier, le conseiller d’État François-René-Jean de Pommereul fut nommé directeur général de la Librairie et de l’Imprimerie. À la même date, Marie-Joseph Néri de Corsini prit la place de Portalis au sein du conseil du Sceau des titres. Enfin, le 4 avril 1811, Napoléon signa le décret d’exclusion du Conseil d’État. C’était la première fois qu’un membre de la Haute Assemblée était révoqué. La décision n’était pas contraire aux textes puisque les conseillers d’État ne l’étaient à vie qu’après avoir exercé cinq années en service ordinaire. Portalis avait été nommé conseiller le 4 janvier 1808, soit exactement trois ans plus tôt [28]. Un seul autre conseiller sera exclu jusqu’à la chute de l’Empire : le préfet de la Seine Frochot, coupable d’avoir cru à la conspiration du général Malet, en octobre 1812 [29].
Le 11 janvier 1811, Portalis quitta Paris, en compagnie de sa femme et de deux de leurs enfants [30]. Il passa la fin de l’hiver à Auxonne, resta ensuite quelques temps à Lyon et, enfin, s’installa dans la maison familiale des Pradeaux, à Saint-Cyr-sur-Mer. Il meubla ses loisirs forcés avec des lectures, de l’écriture et la mise en forme d’un ouvrage de son père sur la philosophie du XVIIIe siècle qu’il fera paraître en 1820 [31].
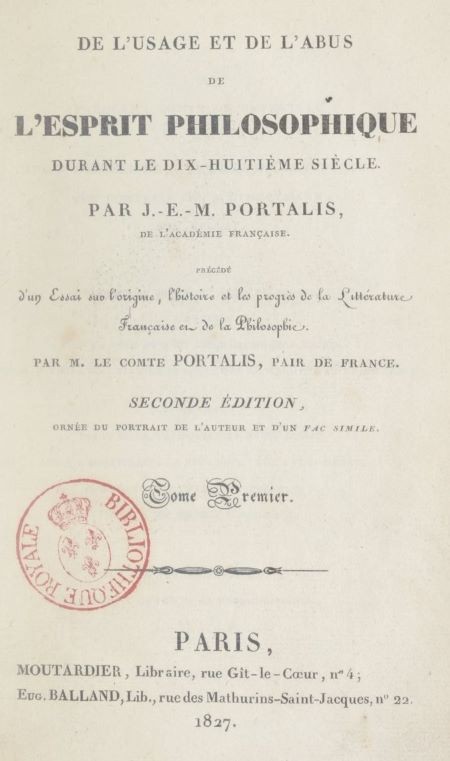
Il siégea aussi à la Société des sciences, des lettres, de l’agriculture et des arts d’Aix, qu’il présida même, de mai 1812 à mai 1813. Sans oublier la nature de sa faute, Napoléon le laissa en paix et ne prescrivit aucune surveillance particulière de son ancien protégé, si l’on en juge par l’absence de son nom dans les bulletins de police. Le temps passa et l’empereur leva l’interdiction de séjourner à Paris, en mai 1813. Sur proposition du ministre de la Justice Molé, Portalis fut finalement nommé Premier président de la cour impériale d’Amiens, le 2 décembre 1813. Il prit ses fonctions le 14 janvier suivant.
Revenant à Sainte-Hélène sur la pénible scène du 4 janvier 1811, Napoléon avouera à Las Cases qu’il se la reprochait : « Il me dit pourtant qu’il y reconnaissait quelque chose de trop ; qu’il eût dû s’arrêter avant de lui commander de sortir. La scène eût dû finir […]. Que le souverain a toujours tort de parler en colère » [32]. Disons cependant que, dans le contexte et vu la gravité des faits, la sanction contre Portalis était justifiée, même si la forme choisie est discutable. La fronde religieuse était, du point de vue de Napoléon, une remise en cause de son autorité. Par sa violente sortie, il avait voulu montrer qu’il ne le tolérait pas, et encore moins d’un proche. Il écrivit alors qu’il avait chassé Portalis pour « que l’on soit bien convaincu de [son] intention prononcée de faire cesser cette lutte scandaleuse de la prêtraille contre [son] autorité » [33]. L’heure était plus que jamais aux mesures énergiques, dussent-elles être prises contre un collaborateur jusque-là apprécié et choyé.
Thierry Lentz, directeur général de la Fondation Napoléon
Notes
[1] Souvenirs de feu le duc de Broglie, Calmann Lévy, 1886, t. I, p. 123.
[2] Ibid.
[3] Le conseil du Sceau du titre avait été créé par un décret du 1er mars 1808 afin de veiller au bon fonctionnement du système « nobiliaire ». Portalis était un des deux conseillers d’État appelés à y siéger, sous la présidence de Cambacérès.
[4] Un décret du 5 février 1810 avait créé cette Direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie au sein du ministère de l’Intérieur, pour surveiller les professions d’imprimeur et de libraire, ainsi que la production d’ouvrages dans tout l’Empire. Elle employait dix-huit censeurs, un commissaire de police spécialement affecté, 35 inspecteurs et 32 commissaires-vérificateurs dans les départements (voir Th. Lentz (dir.), Dictionnaire des institutions du Consulat et de l’Empire, Tallandier, 2016).
[5] Napoléon à Bigot de Préameneu, ministre des Cultes, 16 novembre 1810, dans Napoléon Bonaparte, Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon [désormais : Correspondance générale], Fayard, 2014, tome X, n° 25264.
[6] Certains contemporains pensent que c’est Pie VII en personne qui exigea de Maury qu’il félicite Napoléon pour son avènement, dans les termes les plus élogieux (voir par exemple : Ferdinand de Bertier, Souvenirs inédits d’un conspirateur, Tallandier, 1990, p. 109).
[7] Mémoires de la comtesse de Boigne, Mercure de France, 1999, t. I, p. 239.
[8] Mémoires de Mme la duchesse d’Abrantès, Bruxelles, Société belge de librairie, éd. 1837, t. II, p. 340.
[9] Bref du pape au cardinal Maury, 5 novembre 1810, Correspondance de la Cour de Rome, sans nom d’éditeur (publication clandestine), 1814, t. I, pp. 167 et suivantes. Pie VII adressa un bref identique, le 30 novembre 1810, à Osmond lors de sa nomination à Florence.
[10] Jean-Luc Chartier, Portalis, père du Code civil, Fayard, 2004, p. 342.
[11] Voir : Jacques-Olivier Boudon, Les élites religieuses à l’époque de Napoléon. Dictionnaire des évêques et vicaires généraux du Premier Empire, Nouveau Monde éditions-Fondation Napoléon, 2002, p. 51, et, plus ancien et hagiographique, R. P. Causette, Vie du cardinal d’Astros, Paris, Vaton, 1853.
[12] Voir les lettres adressées par Napoléon à Lavalette, directeur général des Postes, et Savary, dès le 28 novembre 1810, Correspondance générale, tome X, n° 25378 et 25382. On ne peut ici suivre le duc de Broglie qui écrit, parlant de Portalis : « Son crime était de n’avoir point ignoré ce que personne n’ignorait ».
[13] Rapport du ministre des Cultes, 31 décembre 1810, A. N., AF IV 1047 ; lettre de Napoléon à Bigot de Préameneu, 31 décembre 1810, Correspondance générale, tome X, n° 25589.
[14] Mémoires de Cambacérès, Perrin, 1999, t. II, p. 363.
[15] Rapport de Savary, 2 janvier 1811, AN, AF IV 1048. Le même raconte assez honnêtement l’épisode dans ses Mémoires du duc de Rovigo pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon, Bossange, 1829, t. V, p. 93 et suivantes.
[16] Après son séjour à Vincennes, d’Astros redeviendra vicaire capitulaire en 1814. Il sera évêque d’Orange en 1817 mais comme ce diocèse ne sera finalement pas créé, il passera à Bayonne, le 4 mars 1820. Archevêque, de Toulouse, le 30 septembre 1830, créé cardinal le 30 septembre 1850, il mourra à Toulouse le 29 septembre 1853.
[17] Journal de l’Empire du 25 janvier 1811.
[18] Mémoires de Cambacérès, t. II, p. 363.
[19] Baron Fain, Mémoires, Arléa, éd. 2001, p. 123.
[20] Au même moment, à Florence, le chapitre a contesté la nomination de l’archevêque d’Osmond.
[21] Conspiration de l’an XII, menée par Georges Cadoudal.
[22] « Procès-verbal de la séance du 4 janvier 1811 », dans Jean Bourdon, Napoléon au Conseil d’État. Notes et procès-verbaux inédits de Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État, Berger-Levrault, 1963, p. 199-200.
[23] Histoire de mon temps. Mémoires du chancelier Pasquier, Plon, 1893, t. I, p. 442.
[24] Napoléon a ainsi raconté la scène, assez proche du compte rendu officiel, à Las Cases. On la retrouve tant dans les versions imprimées que dans notre édition du manuscrit original (Le Mémorial de Sainte-Hélène. Le manuscrit retrouvé, Perrin, 2017, 1-4 novembre 1815).
[25] Pasquier, op. cit., p. 445.
[26] Dans Charles Durand, Études sur le Conseil d’État napoléonien, PUF, 1949, p. 364.
[27] Lettre de Napoléon à Savary, 4 janvier 1811, Correspondance générale, n° 25634.
[28] Portalis avait été d’abord en service extraordinaire, puis en service ordinaire à la section de l’Intérieur et enfin en service ordinaire hors section (février 1810).
[29] Si la procédure fut pour Portalis la même que celle utilisée pour l’exclusion de Frochot, le Conseil d’État avait dû lui-même produire un rapport approuvant la décision de l’empereur. Nous ne l’avons pas retrouvé.
[30] Bulletin de Police des 13 et 14 janvier 1811. Rappelons que Portalis s’était marié le 9 mai 1801 avec Frédérique Ernestine « Ina » de Holck. Ils eurent cinq enfants viables : Julie (1803), Frédéric (1804), Harold (1810), Joseph (1816) et Jules (1822).
[31] De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique au XVIIIe siècle, Paris, 1820, 2 volumes.
[32] Las Cases, op. cit., 23 mai 1816.
[33] Lettre circulaire à Eugène, Borghèse et Élisa, 5 janvier 1811, Correspondance générale, tome X, n° 25639.
En complément
►Retrouvez sur Napoleonica® les archives les imprimés de travail du Conseil d’État, qui regroupent les projets de textes examinés en séance par le Conseil d’État de 1800 à 1814. Cet ensemble a été composé par Joseph Marie de Gérando dans l’exercice de ses fonctions au Conseil d’État. Elle est actuellement conservée à la Bibliothèque du Conseil d’État. L’intégralité de la collection Gérando a été numérisée en l’an 2000 grâce au mécénat de la Fondation Napoléon.
Mise en ligne : 15 janvier 2024


