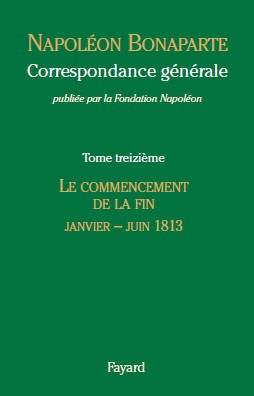Seul, déjà si seul
Les abords du palais paraissaient déserts. Bientôt les lampes quinquets des Tuileries allaient briller de leurs derniers feux tandis que les sentinelles allaient et venaient dans le plus grand silence. La nuit du 18 au 19 décembre 1812 était froide et morne, si semblable à toutes les autres, quand soudain, l’allure vive d’une voiture troubla la sérénité des lieux. Sous les yeux stupéfaits des fiers grenadiers de la Garde impériale, elle passa en trombe sous l’arc de triomphe du Carrousel, un honneur seulement réservé à l’empereur. Qui osait ainsi braver l’interdit ? Personne ne se précipita cependant pour l’arrêter. Dans la berline, on entendit murmurer : « C’est d’un bon augure ». Arrivé devant les grilles du palais, le cocher tira sur les rênes de chevaux harassés par leur course folle dans la capitale. Au poste du pavillon de l’Horloge, les factionnaires s’approchèrent de la vitre de la voiture. Pour se faire reconnaître, l’un des passagers déboutonna sa triste redingote. À la vue des broderies qui rehaussaient son uniforme, le chef de poste ordonna l’ouverture de la lourde porte donnant accès au jardin. Sans doute un porteur de dépêches pensa-t-il. L’équipage chemina ensuite lentement jusqu’à une porte dérobée menant aux appartements de l’impératrice situés au rez-de-chaussée de l’imposant palais. Dès qu’il les aperçut, un valet de pied à peine réveillé se porta à la rencontre de ces visiteurs du soir d’un genre particulier, fort surpris qu’ils n’aillent pas se présenter dans le grand vestibule. À la lumière hésitante de sa torche, le valet peinait à reconnaître le premier voyageur, si poussiéreux et portant une barbe de quinze jours. Affublé d’une toque fourrée, celui qui le suivait était également méconnaissable. L’homme au poil en broussaille déclina alors son identité : « Je suis le grand écuyer Caulaincourt ». Interloqué, le valet qui n’en croyait pas un mot courut appeler sa femme pour qu’elle l’aide à identifier ces personnages singuliers. La plus grande prudence s’imposait depuis qu’au mois d’octobre, une conspiration ourdie par le général Malet avait failli renverser le régime. « Ce ne fut pas sans peine et sans s’être bien frotté les yeux, lui et sa femme, qui me tenait la lumière sous le nez, qu’ils me reconnurent » témoigna plus tard le grand officier (Caulaincourt, Mémoires, Paris, Plon, 1933, t. II, p. 350). En petit cortège, tous se rendirent ensuite vers les antichambres de la souveraine. Dans l’enfilement des pièces, la domesticité qui achevait son service scrutait le visage du mystérieux compagnon du grand écuyer. On crut le reconnaître. Aussitôt, un cri résonna dans le palais : « C’est l’empereur ». L’atmosphère changea alors subitement, l’excitation gagna les esprits. L’impératrice qui venait à peine de se coucher fut alertée par cette effervescence soudaine. Le plan de Napoléon venait d’échouer. En rentrant incognito et en silence, il comptait bien surprendre dans son lit une épouse rongée par l’angoisse depuis qu’elle avait appris les déboires de la Grande armée dans la lointaine Russie. Touchante et étonnante attention de la part d’un homme qui revenait de l’enfer blanc. Accompagné par un joyeux tumulte, les femmes de service laissèrent entrer Caulaincourt puis l’empereur dans les appartements de la souveraine. Dans l’embrasure de la chambre de Marie-Louise, Napoléon congédia son grand écuyer : « Bonsoir, Caulaincourt. Vous avez aussi besoin de repos » (Ibid., p. 351.). Lui même disposait de peu de temps pour reprendre des forces. Il avait un Empire à sauver et une armée à reconstruire.
L’entreprise s’annonçait titanesque et pourtant, l’empereur allait relever le défi. Grâce au tome de cette correspondance consacrée à la première moitié de l’année 1813, nous devenons ses compagnons privilégiés comme introduits dans ce que j’ai pu appeler le « cœur du secret » (Napoléon et ses hommes-La Maison de l’empereur, Paris, Fayard, 2011, pp. 174-181.). Tel son secrétaire Fain, nous sommes témoins de son prodigieux travail de reconstruction. Ses mots vifs témoignent de son incroyable énergie. Dans sa correspondance privée ou officielle, l’empereur se livre presque toujours et masque peu ses émotions. L’homme nous apparaît alors dans la nudité de ses sentiments et parfois la naïveté de ses espoirs. Jamais, il n’a autant dicté, répétant, insistant, scrutant chaque détail et paraissant plus déterminé que jamais. Tandis que les craquements au sein de son Empire ne peuvent plus être ignorées, il ne paraît pas faiblir comme si les mauvaises nouvelles n’avaient pas prises sur lui. Mieux, elles semblent le galvaniser. Il se montre même si sûr de lui que dans les premiers jours de janvier, il ne dissimule rien de ce qui est survenu à son armée. Aujourd’hui encore, il est difficile d’avancer précisément le chiffre des pertes en hommes de la terrible campagne de Russie. Autour de 600 000 hommes sans doute. Dans une étude récente, Jean-François Brun fait état d’une statistique terrible : à peine 4 % des soldats de la ligne seraient revenus indemnes de la terrible campagne (Jean-François Brun, L’économie militaire impériale à l’épreuve de la VIe coalition, Thèse de doctorat sous la direction d’Abel Poitrineau, Université Blaise Pascal (Clermont Ferrand), 1992, p. 34 et suivantes.). Souvent employé à propos des restes de la Grande armée, le mot débris prend ici tout son sens. Des débris, à peine 12 000 hommes, qui allaient se cramponner à tout ce qui s’offrait à eux, rivières, villes ou place fortes pour arrêter le torrent russe. Avec ses alliés, l’empereur joue apparemment la carte de la franchise comme en témoigne sa lettre au roi Frédéric VI du Danemark : « Le 7 novembre, le froid est devenu excessif ; tous les chemins se sont trouvés impraticables ; 30 000 de nos chevaux périrent du 7 au 16. Une partie de nos voitures de bagages et d’artillerie furent cassées et abandonnées ; nos soldats, peu accoutumés à se garantir du froid, ne purent endurer un froid de 18 à 27 degrés. Ils s’éloignaient des rangs pour chercher des abris la nuit, et, n’ayant plus de cavalerie pour les protéger, plusieurs milliers tombèrent successivement entre les mains des troupes légères de l’ennemi. […] Mes pertes sont réelles, mais l’ennemi ne peut s’en attribuer l’honneur. Mon armée a beaucoup souffert et souffre encore ; cette calamité cessera avec le froid » (À Frédéric VI, n° 32212.). Entre les lignes, l’émotion est presque palpable. Le tableau est presque émouvant, sans doute l’empereur est-il encore un peu remué par ce qu’il vient de vivre mais dans sa plume, le calcul qu’il soit politique ou diplomatique n’est jamais absent. À le lire, il n’a été vaincu que par un seul ennemi : le froid et en suivant sa logique, une fois le printemps arrivé, sa suprématie militaire ne pouvait qu’à nouveau éclore. Et quant au tsar de toutes les Russies et ses hordes de Cosaques, ils comptent au fond pour si peu dans les évènements tragiques, voire effroyables, que son armée venait d’endurer. La réalité fut, on le sait tout autre. En vérité, l’empereur fut vaincu en raison d’une stratégie meilleure et d’une organisation chaque jour plus efficace de l’ennemi russe comme l’attestent de très récentes études (Voir notamment Marie-Pierre Rey, L’effroyable tragédie, Paris, Flammarion, 2012 et Dominic Lieven, La Russie contre Napoléon-La bataille pour l’Europe (1807-1814), Paris, Edition de Syrtes, 2012.). Plus inquiétant encore, à la fin de la campagne, les réserves en hommes et en chevaux du tsar Alexandre apparaissent infiniment supérieures à celles de l’empereur des Français.
À son frère Jérôme, le 18 janvier, il écrit aussi : « Votre Majesté peut apprécier les faussetés débitées par les bulletins russes, s’ils sont parvenus à sa connaissance. Il n’y a pas en une affaire où les Russes aient pris un seul canon et une seule aigle ; ils n’ont pas fait d’autres prisonniers, en front de bandière, que des tirailleurs, dont on prend toujours un certain nombre, alors même qu’on est battu. Ma Garde n’a jamais donné ; elle n’a pas perdu un seul homme dans une action, elle n’a donc pas pu perdre des aigles, comme les bulletins russes le publient » (À Jérôme, Correspondance générale, n° 32332.). Dans la même veine, si le fameux XXIXe bulletin de la Grande armée révéla aux Français la triste réalité, il se conclue sur cette note : « La santé de Sa Majesté n’a jamais été meilleure ». Comme si au fond perdre une armée toute entière importait peu, du moment que son capitaine en avait réchappé : « Familles, séchez vos larmes : Napoléon se porte bien » persiflera ensuite Chateaubriand (Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe, Paris, Gallimard, 1951, t. I, p. 832.). En creux, il fallait comprendre aussi que celui que Clausewitz surnomma le « Dieu de la guerre » se présente au mieux de sa forme pour à la fois reprendre en main son destin et réparer les outrages infligés par le seul général hiver. Dans les premiers jours de janvier, Napoléon doit d’abord calmer les inquiétudes. Aussi remplace-t-il les traditionnels vœux du nouvel an par des messages tous plus rassurants les uns que les autres. À l’en croire, malgré l’accident russe, sa puissance est à peine entamée : « Quant à la France, il est impossible d’en être plus satisfait que je le suis : hommes, chevaux, argent, on m’offre tout. Heureusement, mes mesures étaient prises d’avance et je n’ai besoin d’aucun mouvement extraordinaire. Mes finances sont en bon état ; mon budget de 1813 que je viens d’arrêter m’assure 1 100 000 000 Fr. en argent et j’ai convoqué au premier de février le Corps législatif pour lequel il est d’usage de publier tous les comptes. Si, comme je ne puis en douter, l’Autriche, le Danemark, la Prusse ne changent pas de système, je ferai la guerre avec mes recettes ordinaires » assure-t-il à son beau-père, l’empereur d’Autriche (Lettre du 7 janvier à François Ier, Correspondance générale, n° 32230.). Il faut bannir le doute et en habile propagandiste, l’empereur y veille.
Tout amateur de la correspondance de Napoléon connaît sa passion pour l’infiniment petit comme son incroyable capacité à tracer de grands desseins, qu’ils soient militaires, politiques, dynastiques ou diplomatiques. L’homme était en mesure de définir simplement et précisément chacun des systèmes qu’il voulait voir appliquer tout en s’évertuant à en peaufiner chaque détail, un peu à la manière d’un artiste qui retoucherait indéfiniment sa toile en corrigeant ici ou là quelques nuances. En janvier, l’urgence est à la reconstitution de son armée. « Donnez des ordres », « Ordonnez », « Prenez des mesures » ou « Dirigez » sont les mots qui reviennent le plus souvent sous sa plume. L’énergie qu’il allait déployer pour acheminer vers la Saxe une armée en état de combattre se passe de commentaires. Jamais il n’a autant dicté que pendant les six premiers mois de 1813 : 2925 lettres (La Fondation Napoléon et le directeur de volume remercient ici très chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de cet ouvrage, et notamment Michèle Masson, Patrick Le Carvèse et Jean-Pierre Vérité pour leur travail de relecture ; Jean-Pierre Pirat pour la réalisation des cartes, Bertrand Fonck et Michel Roucaud pour leur travail sur l’index, ainsi que les conservateurs des Archives nationales, des Archives du ministère des Affaires étrangères et du Service historique de la Défense.) dont 707 pour le seul mois de juin. Ce record démontre que ses capacités loin d’être entamées étaient, au contraire, non seulement intactes mais peut être plus aiguisées que jamais. Page après page, le génial architecte est à l’œuvre. Se livrant avec ses secrétaires à d’interminables dictées, il lève, prélève, déplace, affecte, réaffecte, ajoute ou réajuste hommes et subsistances aux quatre coins de son Empire. Face à l’ennemi sur la Vistule, il organise la défense. En vue de reprendre l’offensive et pour à nouveau créer la surprise, il lui faut cependant dénicher du sang frais. 60 000 hommes, c’est tout ce qu’il lui reste au-delà de l’Elbe alors que les ressources de la conscription 1812 sont épuisées (on peine à trouver 1 822 soldats en état de prendre la route) et que celles de la conscription 1813 commencent à peine à entrer dans les casernes (137 000 hommes) (Voir à ce sujet l’excellente étude du commandant Lanzerac, La manœuvre de Lützen, Institut de stratégie comparée, EPHE IV Sorbonne, p. 22-23.). Pour reconstituer son armée, Napoléon doit recourir à des levées exceptionnelles. Sur le papier 647 000 hommes sont convoqués tandis que 80 000 autres, pris sur les anciennes classes, sont rassemblés pour former des troupes auxiliaires appelées cohortes. Ces dernières sont affectées aux dépôts et garnisons de l’intérieur de l’Empire, ce qui permet d’extraire des casernes des dizaines de milliers de soldats aguerris pour combattre en Saxe. Au 20 avril, la Grande armée divisée en six corps compte 210 000 fantassins dont 175 000 français. Parmi ces derniers, une grande majorité (plus de 100 000) possède plus d’une année d’expérience, ce qui dément l’idée parfois reçue selon laquelle l’armée de 1813, du moins dans la première partie de la campagne, n’était constituée que de conscrits n’ayant jamais vu le feu. Mais, si l’artillerie est excellente, la cavalerie (environ 15 000 hommes) est en sous-effectif à la veille de l’entrée en campagne. Malgré cette insuffisance, l’armée de Napoléon apparaît redoutable. Elle allait d’ailleurs prouver toute sa valeur dans les batailles à venir. En quelques semaines seulement, le « Dieu de la guerre » accomplit ainsi le prodige de recréer régiments et divisions après être rentré dans sa capitale dans les conditions que l’on connaît.
Une fois ses unités reconstituées, on imagine volontiers Napoléon penché sur ses cartes, épingles de couleurs à la main, faisant progresser ses unités de papiers tout en calculant chaque ration, chaque distance et s’interrogeant sur les qualités de ceux qui commandent. Le facteur humain, aléatoire par nature, l’inquiétait cependant. Pour combattre l’incertitude, il nomma avec soin ceux qui vont animer ses unités, interrogeant sans cesse son ministre de la Guerre Clarke à propos de tel ou tel général. Concernant les subsistances, l’intendant Daru et le ministre de l’administration de la Guerre sont également constamment sollicités. Le calcul étant l’un de ses passe-temps favori, il en use et même en abuse pour tenter de tout maîtriser. On pourrait citer mille exemples issus de ce volume, tel cette lettre adressée à Eugène et datée du 24 janvier : « Mon Fils, j’ai reçu une lettre du comte Daru, du 17 janvier. Je vois qu’il y a à Stettin 1 500 000 rations de farine, 500 000 rations de biscuit, 800 000 rations de riz et de légumes secs, 11 millions de rations de sel, 300 000 rations d’eau-de-vie, 300 000 rations de vin, 300 000 rations de bière, 300 000 rations de vinaigre, 1 million de rations de viande salée, 400 000 rations de foin, 400 000 rations de paille, 200 000 rations d’avoine ou orge, 1 million de rations de bois. Cet approvisionnement me paraît fort satisfaisant. Le comte Daru calcule sur une garnison de 2 800 hommes et 800 chevaux : cette base est fausse. On ne peut avoir à Stettin une garnison moindre de 4 000 hommes, ni un approvisionnement pour moins d’un an ; mais 2 millions de rations de farine ou biscuit, à 5 000 rations par jour (car pour une garnison de 4 000 hommes il faut compter 5 000 rations), suffisent pour 400 jours ; 800 000 rations de riz et de légumes pour 200 jours ; le vin, l’eau-de-vie, la bière et le vinaigre pour 300 jours ; 1 million de rations de viande salée pour 200 jours. D’ailleurs, en cas de besoin, le commandant aurait soin de ramasser dans les environs 5 ou 600 bœufs ; ainsi on peut être sans inquiétude sur l’approvisionnement de cette place » (Ci-dessous, n° 32447.). On ne saura jamais exactement si officiers et intendants ont pu ne serait-ce que vérifier ses interminables calculs. En tout cas, mettre ainsi tout en chiffres rassure sans doute Napoléon, lui donnant l’impression de commander à nouveau aux êtres et aux choses. La maîtrise en toutes choses, encore et toujours, voilà l’un des mots clefs de cette correspondance.
Pour élaborer ses modèles mathématiques, l’empereur se montre avide d’informations. Nous savons qu’il nourrit sa réflexion notamment avec la lecture des bulletins de police ou avec les rapports de situation militaire. Mais, d’un naturel méfiant, il vérifie toujours l’information officielle en utilisant d’autres sources. Dans ce volume, on croise ici ou là plusieurs exemples de cette méthode. Officiers d’ordonnances et aides de camp reçoivent ainsi plusieurs missions officielles mais néanmoins discrètes. Si les données humaines ou matérielles lui sont essentielles pour méditer manœuvres et offensives, la géographie est également un élément clef de sa stratégie. La configuration du terrain ne doit avoir aucun secret pour lui comme en témoigne cette missive à l’officier d’ordonnance Atthalin : « Vous trouverez ci-joint un plan de Minden. Voyez sur-le-champ à Paris le sieur Bouthillier, sous-préfet de Minden, (vous aurez son adresse chez le comte Molé), et ayez avec lui une conversation sur les questions suivantes : Le pont est-il en pierre ? L’enceinte était-elle en pierre ? Y a-t-il de l’eau dans les fossés ? N’y a-t-il de détruits que les parapets ? À quelle distance sont les montagnes qui dominent ? Voyez aussi les officiers du bureau du génie pour savoir s’ils n’ont pas de plan meilleur que celui-ci et s’ils peuvent donner des éclaircissements. Vous-même, n’avez-vous pas passé à Minden ? » (À Atthalin, 14 mars 1813, n° 32214.). L’activité au sein de son cabinet de travail est d’une rare intensité. On imagine sans peine ses secrétaires s’épuiser à la tâche (Les plus grosses journées d’activité du cabinet impérial furent les 16, 17 et 18 juin avec respectivement : 66, 51 et 61 lettres dictées, recopiées et expédiées.). Rien que pour la journée du 22 juin, on dénombre 43 lettres écrites sous sa dictée. Comme à son habitude, l’empereur veille à tout, imagine, redéploye, vitupère ou tance ses subordonnées. Il semble seul aux commandes, ne laissant que très peu d’initiative à ses maréchaux et généraux. Prenons quelques exemples puisés dans cette journée du 22 juin. Dans l’espoir de mieux défendre la place de Kœnigstein, il ordonne par exemple de fortifier les hauteurs de Lilienstein, décrivant avec une précision étonnante ce qu’il exige, tel un commandant supérieur du génie. Puis, quelques lettres plus loin, après avoir réglé le sort d’autres places fortes, il s’intéresse à la pension de la veuve et de la fille de Duroc, ne mégotant aucun détail sur ce qu’il convient de faire. Ensuite, la guerre le préoccupant à nouveau, il se met à former et recomposer régiments et bataillons avant de s’étonner auprès de l’intendant Daru, des carences de son administration. Une courte lettre à Marie-Louise laisse entrevoir son humeur du jour. Elle se conclue ainsi : « Ma santé est fort bonne. Je t’aime de tout mon cœur. Tout à toi » (Ci-dessous, n° 34343.). On ne saurait être moins télégraphique. Enfin, Napoléon n’oublie point ses espions comme en témoigne cette lettre au maître espion Lelorgne d’Ideville : « Votre agence me rend très peu de services. Vous ne m’avez pas encore remis un seul rapport de Bohême, où tout le monde pénètre si facilement. Vous ne m’en avez remis aucun de Berlin, ni du Mecklenburg, ni de la Pologne. Vous n’avez pas même su découvrir où étaient les partisans, qui se trouvaient cependant dans la Saxe même. Vous nous réduisez à la traduction des journaux : c’est quelque chose, mais ce n’est pas assez. Il paraît que votre affaire n’est pas bien organisée, car vous ne réussissez en rien. Dans aucune campagne je n’ai été aussi mal servi » (À Lelorgne d’Ideville, 22 juin 1813, n° 34941.). Tout au long des 2 925 lettres qui composent ce volume, le thème est récurrent : on le sert mal, d’où d’incessantes mises en garde à ses généraux, maréchaux ou ministres. Dans son esprit, les plus capables lui manquent à présent cruellement. Il est vrai que le sort semble s’acharner sur les jeunes officiers qui l’entouraient depuis la première campagne d’Italie. Gouverneur des provinces illyriennes, le maréchal Junot sombre ainsi dans la folie au mois de juin, se promenant dans le plus simple appareil avec comme seul vêtement le grand cordon de la Légion d’honneur. De Dresde, le 22, Napoléon écrit à Clarke : « Monsieur le duc de Feltre, je vous envoie une dépêche de Trieste qui me paraît fort extraordinaire. Faites-le vérifier. Écrivez-en au commissaire-général et au duc d’Abrantès lui-même. Si le fait se trouvait vrai, il faudrait ôter l’autorité à un homme qui se serait avili jusqu’à ce point » (Ci-dessous, n° 34931.). La mort a déjà fauché tant de ses compagnons de gloire. En mai, il perd l’un de ses plus proches officiers, peut-être même son seul ami, le grand maréchal Duroc. Puis, il y eut aussi la disparition du maréchal Bessières. Il semble à chaque fois accablé par tant d’infortune. Dans ses lettres à Marie-Louise, sa peine transparaît : « Ma bonne amie, J’ai été bien triste tout hier de la mort du duc de Frioul. Il est mon ami depuis 20 ans. Jamais je n’ai eu à me plaindre de lui ; il ne m’a jamais donné que des sujets de consolation. C’est une perte irréparable, la plus grande que je pouvais faire à l’armée » (Ci-dessous, n° 34314.).
Aucun doute ne s’insinue cependant dans la prose napoléonienne, l’empereur semblant comme toujours si sûr de lui. Et pourtant, les mauvaises nouvelles ne manquent pas. Dès le début de la campagne, il perd son général en chef. À la tête des restes de la Grande armée depuis le départ de Napoléon, un chef hésitant et fantasque, le roi de Naples, Murat. Inquiet pour son royaume, il laisse sans ordres son commandement dans les premiers jours de janvier. Ensuite, avec des effectifs inférieurs en nombre, cernés et privés d’appuis, plusieurs généraux sont à leur tour contraints de renoncer et déposent les armes. Et parmi les civils administrant les nouveaux départements, l’inquiétude est palpable, envahissante même. Dans les demeures cossues des caciques du régime, on plie parfois bagage : « Mon cousin, le bruit se répand ici que vos filles et vos nièces quittent Amsterdam et vont jeter l’alarme dans toute la Hollande. Je ne puis croire à une pareille imprudence. Ayez soin qu’aucun Français et aucune Française ne quittent Amsterdam, et que l’on ne montre aucune inquiétude » s’inquiète par exemple Napoléon auprès du gouverneur général Lebrun (À Lebrun, 22 mars 1813, n° 33388.). En Hollande comme en Allemagne, l’angoisse se répand et affole jusqu’aux plus endurcis. Même au sein des ministères, le doute est là. Autour de Napoléon, y compris parmi ses plus fidèles, les certitudes paraissent s’envoler. Parfois, on s’interroge même à haute voix, quitte à braver le courroux impérial, tel le ministre Savary, pourtant considéré comme le « séide » de l’Empereur. À ses interrogations, la réponse de Napoléon sonne comme un désaveu : « Le ton de votre correspondance ne me plaît pas ; vous m’ennuyez toujours du besoin de la paix. Je connais mieux que vous la situation de mon Empire, et cette direction donnée à votre correspondance ne produit pas un bon effet sur moi. Je veux la paix, et j’y suis plus intéressé que personne : vos discours là-dessus sont donc inutiles ; mais je ne ferai pas une paix qui serait déshonorante, ou qui nous ramènerait une guerre plus acharnée dans six mois. Ne répondez pas à cela ; ces matières ne vous regardent pas, ne vous en mêlez pas » (À Savary, 13 juin 1813, n° 34639.). Une idée dangereuse voire mortelle pour l’empereur des Français creuse néanmoins son sillon : et s’il représentait le seul obstacle à la paix ? Dans leurs proclamations comme dans leurs actes, ses adversaires le rendent responsable de tout. L’argument est habile et de nature à semer le trouble. Isoler davantage l’empereur représente sûrement le meilleur moyen de l’abattre.
Début 1813, le bal des défections s’ouvre avec une danse prussienne fort désagréable pour Napoléon. Dès les premiers jours de janvier, le corps auxiliaire prussien du général York s’aligne aux côtés de l’armée russe. Cette « trahison » est suivie de beaucoup d’autres. S’éloignant habilement des troupes françaises, le roi Frédéric-Guillaume tombe le masque quand au mois de mars, son pays entre en guerre contre la France. Tandis que les aigles français reculent partout en Allemagne, les alliés de Napoléon sont en plein désarroi, d’où leur résistance bien timide face à l’envahisseur prussien ou russe. Les troupes saxonnes capitulent ainsi presque sans combattre, laissant les régiments français seuls face à l’ennemi. Le 4 avril, s’adressant à Maret, Napoléon fit mine de s’en étonner : « Il est incroyable que le roi de Saxe abandonne ainsi son pays à quelques Cosaques et n’utilise pas sa cavalerie, qui pourrait le défendre. Les Saxons se conduisent bien mal » (Ci-dessous, n° 33632.). Est-il seulement conscient que l’avancée des soldats russes au-delà de la Vistule engendre une véritable panique parmi les élites tout en réjouissant une partie des populations ? Il semble l’ignorer, s’obstinant à croire que la sédition loin d’être générale ne se limite qu’à quelques fêlons capables de rallier ici ou là des partisans et contre lesquels, il exige la plus grande sévérité s’ils viennent à être capturés. Pour lui, désertions et abandons ne peuvent être causés que par la couardise de tel ou tel officier supérieur. Lettre après lettre, il se désole aussi du manque de vigilance des rois ou princes de la Confédération du Rhin coupables de son point de vue de laisser publier de temps à autre des articles hostiles à son règne dans leurs journaux, comme s’il suffisait de faire taire ici ou là quelques plumes malveillantes pour faire disparaître toute contestation. À son frère Jérôme, le 18 janvier, il confie : « Si ces hommes peuvent entretenir, comme ils s’efforceront de le faire, des intelligences au sein de la Confédération, et y souffler l’esprit qui les anime, des maux sans nombre et sans mesure peuvent fondre tout à coup sur elle. De l’énergie que les souverains vont développer dépendent et la tranquillité des peuples et l’existence des Maisons qui règnent sur les divers États confédérés. J’ai garanti l’existence de leurs princes, je l’ai garantie et contre leurs ennemis extérieurs et contre ceux qui, à l’intérieur, voudraient attenter à leur autorité. Je remplirai mes engagements ; les grands sacrifices que j’impose à mes peuples, les grandes mesures que je viens d’adopter, n’ont d’autre but que de les remplir. Mais, quand je ferai tout pour les souverains confédérés, je dois espérer qu’ils ne s’abandonneront pas eux-mêmes et ne trahiront pas leur propre cause. Ils la trahiraient, s’ils ne concouraient pas avec moi de tous leurs moyens, s’ils ne prenaient pas les mesures les plus efficaces pour mettre dans le meilleur état leur infanterie, leur artillerie, leur cavalerie surtout, s’ils ne faisaient pas tout ce qui dépend d’eux pour que la guerre soit éloignée de l’Allemagne et que tous les projets de l’ennemi soient déjoués. Ils la trahiraient encore, en ne mettant point les agitateurs de toute espèce dans l’impuissance de nuire, en laissant les feuilles publiques égarer l’opinion par des nouvelles mensongères, ou la corrompre par des doctrines pernicieuses, en ne surveillant point, avec une inquiète vigilance, et les prédications et l’enseignement, et tout ce qui peut exercer quelqu’influence sur la tranquillité publique » (À Jérôme, 18 janvier 1813, n° 32332.).
Tout au long de cette première moitié de l’année 1813, Napoléon sous-estime et rabaisse son ennemi, d’où une profonde incompréhension entre lui et ses subordonnés. À leurs inquiétudes, il répond par le mépris et enrage contre tous ceux qui reculent. La lettre datée du 25 juin envoyée à Berthier est de ce point de vue édifiante : « Écrivez au général Laplane qu’il ne sait ce qu’il dit. Il croit que l’ennemi a 45 000 hommes campés à Kalisch. Ce sont des contes qu’on lui fait : il n’y a pas un seul homme sur la ligne d’opération de la place, pas même à Kalisch. Dites-lui que ceux qui lui font de pareils rapports, ne peuvent être que des espions qui méritent d’être fusillés » (Ci-dessous, 34991.). Sa science ne pouvant qu’être exacte, l’empereur déteste que l’on vienne déranger ses calculs par ce qu’il croit être de la désinformation, paraissant comme prisonnier d’un système mathématique dont il ne peut ou ne veut se défaire. Vainqueur sur le papier, toute défaite ou fuite devant l’ennemi ne peuvent être causée que par une lâcheté devant l’épreuve. Dans ce volume, les colères de l’empereur face à ce qu’il estime être de la pure couardise abondent. Parmi les dizaines de capitulations qui truffent cette campagne, celle de Spandau est comme tant d’autres sévèrement jugée par Napoléon. Le 24 avril, dans la place, tout est perdu lorsque l’explosion du magasin de poudre fait disparaître une muraille. En passe d’être submergé par le nombre, le commandant de Spandau, le général baron de Bruny, n’a d’autres choix que de négocier sa reddition. De Lützen, le 2 mai, l’empereur intransigeant ordonne son arrestation immédiate, affirmant que « la présomption est contre le conseil de défense » (Lettre à Berthier, n° 34091.). Procureur sévère, il accuse parfois contre l’évidence tant de ses généraux mais une fois sa colère dissipée, les instances militaires répugnent à condamner leurs frères d’armes et presque aucune carrière ne sera brisée. L’Empire n’avait rien de totalitaire. On ignore encore si ne serait-ce qu’un soldat connut le peloton d’exécution pour avoir reculé devant l’ennemi. Même sévèrement atteinte, l’armée française ne sombre pas dans la terreur, en passant par les armes les prétendus couards ou en violentant systématiquement les populations civiles. Et pourtant, concernant ces dernières, presque partout en Allemagne, les ennemis de la France sont plutôt bien accueillis voire même acclamés quand ils font leur entrée dans villes et villages. Aucune résistance ne se dresse ainsi pour contrarier la marche des troupes russes. C’est même tout le contraire, des partisans se lèvent en nombre pour accompagner leurs mouvements. Au lieu de les sanctionner durement quand il reprend l’avantage, Napoléon joue in fine la carte de la modération. Le meilleur exemple concerne la ville de Hambourg. Pendant les quelques semaines où la ville passe sous contrôle russe, les preuves de collusion entre anciens sujets de l’Empire et soldats ennemis sont légions. En réaction, le 7 mai, l’empereur semble dans un premier temps décidé à faire un exemple. Par l’entremise de Berthier, il ordonne au maréchal Davout : « Voici la conduite qu’il a à tenir. Il fera arrêter sur-le-champ tous les sujets de Hambourg qui ont pris du service sous le titre de sénateurs de Hambourg. Il fera traduire à une commission militaire et fusiller les cinq plus coupables, et il enverra les autres sous bonne escorte en France, pour être détenus dans une prison d’État […] Il fera désarmer toute la ville, fusiller les officiers de la légion hanséatique, et enverra tous ceux qui auront pris emploi dans cette troupe, en France, pour être mis aux galères […] Il fera une liste de prescription de 500 individus de la 32e division militaire, les plus riches et qui se sont le plus mal conduits ; il les fera arrêter, et fera mettre le séquestre sur leurs biens, dont le domaine prendra possession » (Ci-dessous, n° 34152.). Puis au fil de sa correspondance, il oublie un peu son ressentiment contre la « canaille », n’exigeant plus que des sanctions financières et s’intéressant avant tout à l’armement de la ville. Le prix à payer fut certes considérable : 50 millions de francs, ce qui équivalait à plusieurs années d’imposition, mais rien de comparable avec l’horreur de l’impôt du sang. Mieux valait en effet épargner cette ville afin qu’elle devienne à la fois un point fort du dispositif défensif français et qu’elle soit à même de renflouer des finances impériales de plus en plus délicates.
De manière récurrente, Napoléon s’interroge sur l’attitude de l’Autriche, essayant d’interpréter le moindre signe venant de Vienne. Peu à peu, son optimisme premier laisse place à une certaine méfiance tant l’attitude de « Papa François » (À Marie-Louise, 25 juin 1813, n° 35022.) apparaît chaque jour davantage suspecte. Sur le terrain, le corps auxiliaire autrichien, pourtant fort de 40 000 hommes et en situation de menacer les arrières de l’armée russe, reste étonnamment l’arme au pied, se contentant seulement de protéger la Galicie. Le 17 mars à Kalisch, une convention secrète entre les deux puissances est même signée, réglant dans ses moindres détails ce qu’il faut appeler un simulacre de campagne militaire. Les commandants et autrichiens s’entendent alors pour opérer de concert retraites et offensives comme à la parade. Tout ceci n’avait qu’un but : occuper les positions souhaitées et surtout duper l’empereur des Français. Certes, aucune alliance le lie encore formellement l’Autriche et la Russie mais à tous niveaux, leur entente est bien réelle. En outre, l’Autriche réarme puissamment. De quoi inquiéter Napoléon même si longtemps, il combat tout défaitisme : « Monsieur le duc de Feltre, répondez au général Vignolle que notre situation politique avec l’Autriche est des plus amicales, que tous ces bruits alarmants qu’on fait courir en Italie sont propagés par les Anglais sur toutes les côtes de l’Empire. Il serait convenable que vous écrivissiez dans ce sens à tous les commandants des divisions militaires maritimes, pour leur faire connaître cette tactique des Anglais » écrit-il notamment à son ministre de la Guerre (À Clarke, 18 février 1813, n° 32821.). Tout indique qu’il crût ou du moins espéra longtemps que l’Autriche resterait son alliée. Au maréchal Ney le 5 avril, il se dit encore « très sûr » de la fidélité de Vienne (À Ney, 5 avril 1813, n° 33662.). Mais après quelques entretiens franchement décevants avec l’ambassadeur autrichien fraîchement nommé, Schwarzenberg, il comprend que l’Autriche louvoie dangereusement. Dès lors, il juge plus prudent de se préparer au pire avec cette puissance comme le prouve cette lettre au ministre de la guerre datée du 24 avril : « J’ai lieu d’être content des intentions de l’Autriche. Je ne soupçonne pas ses dispositions ; cependant mon intention est d’être en mesure et de ne pas dépendre d’elle. La partie vulnérable à l’égard de l’Autriche est mon royaume d’Italie : mon intention est le plus tôt possible d’y renvoyer le vice-roi. Occupez-vous de tous les moyens de former une armée en Italie » (À Clarke, 24 avril 1813, n° 34377.).
Malgré la prégnance de la chose militaire dans ce treizième volume de la correspondance de Napoléon, les lettres diplomatiques sont nombreuses. À leur lecture, le Napoléon diplomate nous apparait tout aussi bien conciliant et rassurant qu’impérieux ou menaçant. La politique n’est pas non plus complétement absente. Le 15 avril quand l’empereur quitte Saint-Cloud pour aller livrer bataille en Saxe, il confie la régence de l’Empire à son épouse, l’impératrice Marie-Louise. N’ayant pas oublié l’affaire Malet qui avait failli renverser son régime en octobre 1812 en répandant le bruit qu’il avait péri en Russie, il souhaite éviter toute vacance du pouvoir, d’où cette responsabilité confiée à Marie-Louise, qu’assiste cependant l’archichancelier Cambacérès. À vrai dire, il délègue peu ses pouvoirs à sa jeune épouse. De son bivouac, il continue de veiller à la bonne marche de ses affaires, réglant lui-même jusqu’aux détails de procédure au sein du conseil de régence. En outre, on le sait, l’empereur pratique sans retenue le diviser pour régner, pour mieux conforter son pouvoir. Eloigné de Paris et toujours méfiant, il semble qu’il ait voulu par moments opposer les deux têtes de l’exécutif dans le but de prévenir toute entente qui pourrait se nouer à son détriment. Du bivouac de Rosnig, le 30 mai, il critique ainsi ouvertement l’attitude de Cambacérès dans ce billet destiné à son épouse : « Mon amie, J’ai reçu ta lettre du 23 mai. Je suis fâché que tu n’aie pas fait grâce avant d’aller au Te Deum, à l’homme condamné à mort. Ce trait de clémence eût été bien placé dans un jour de réjouissance ; l’archichancelier a été dans cette affaire trop sévère » (À Marie-Louise, 30 mai 1813, n° 34377.). Un mois plus tôt, il s’était adressé à l’archichancelier pour restreindre la liberté d’action de l’impératrice sans même l’en avertir : « Mon cousin, il est nécessaire que la Régente ne signe rien de ce qui est relatif aux gardes d’honneur, à moins d’urgence. Vous me ferez envoyer directement tout le travail ; sans quoi le ministre de la guerre me tirera de l’armée des hommes qui m’y sont nécessaires, pour les placer là » (À Cambacérès, 21 avril 1813, n° 33966.). Plus sévère encore, le 7 juin, il déplore que la représentation impériale soit si mal servie : « Mon cousin, je n’approuve pas que l’Impératrice aille à Notre-Dame. Ces grandes pompes doivent être rares, sans quoi elles deviennent triviales. Si l’Impératrice y allait pour la victoire de Wurschen, elle serait obligée d’y aller pour toutes les autres victoires. Autant il était bien fait d’y aller pour la victoire de Lützen, victoire inattendue et qui a changé la position de nos affaires, autant cette fois ce serait inutile. Avec un peuple comme le nôtre, il faut plus de tenue que cela » (À Cambacérès, 7 juin 1813, n° 34511.). Mais au-delà de ces quelques anicroches au plus haut sommet de l’Etat, il est frappant de constater que l’empereur en campagne ne semble préoccupé sur le plan politique que par les Te Deum joués à Notre-Dame ou par des questions d’étiquette, comme si désormais seules comptent l’imagerie impériale ou les comédies de cour. En marge des palais, l’Empire est pourtant troublé par le sort réservé au pape que Napoléon a fait mettre en résidence surveillé à Fontainebleau. L’intransigeance de l’empereur vis à vis du Saint-Père ranime même une opposition royaliste que l’on croyait définitivement éteinte. De tout cela, Napoléon ne s’en inquiète point. Ne se fiant plus qu’à son seul génie, il s’aveugle chaque jour davantage. Presque un comble quand on entend régenter le monde à ce point.