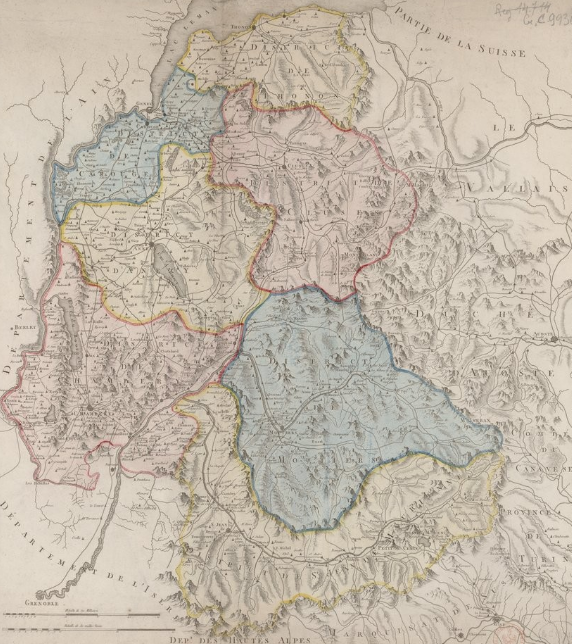La perception des hautes vallées était celle d’un monde encore mystérieux, aux paysages grandioses et effrayants, peuplé d’hommes et de femmes dont la vie était restée simple et les mœurs pures. Comme si les hauts remparts rocheux les avaient préservés des méfaits de la civilisation et que le mythique « âge d’or » perdurait dans ces lieux isolés. Choisi parmi d’autres descriptions similaires, le compte-rendu d’un médecin poitevin contemporain résume bien les sentiments ambivalents des « gens d’en bas » vis-à-vis des « gens d’en haut » :
Le froid, l’aridité des pays montagneux, font pour tous, du travail, un salutaire besoin. La force du corps donne à l’habitant des montagnes le sentiment de sa suffisance, l’énergie de l’âme et le goût de l’indépendance. Il aime la frugalité, la tempérance, et s’honore de la médiocrité. La vue continuelle de ces rochers qui se perdent dans les nuages, de ces précipices dont l’oeil ne peut mesurer la profondeur, enhardit le génie, augmente l’énergie de l’âme, la sensibilité du cœur et la vivacité de l’imagination. C’est là que les peintres et les poètes vont se pénétrer des images du sublime, et que des peuples entiers jouissent de la liberté au sein même du despotisme.[1]
Un environnement hostile
Le climat était la première considération des observateurs, déconcertés ou effrayés par le froid mordant et la neige abondante. Selon les critères sanitaires de l’époque, c’étaient des freins à l’épanouissement des habitants comme en témoigne cette appréciation médicale :
Le vent du nord souffle assez constamment dans ces contrées ; il rend le climat froid, parce qu’il passe sur des pics élevés, où sont amoncelées des glaces éternelles. L’hiver dure longtemps ; la neige séjourne jusqu’à sept à huit mois dans quelques vallées, et leurs habitants sont, pendant ce temps-là, privés de toute communication avec leurs voisins [2]
Les incertitudes climatiques pesaient constamment sur les agriculteurs. Les brusques changements de température et les orages violents qui se transformaient en ouragan ou en pluies de grêle pouvaient détruire les récoltes, et ce au moment de la moisson. La nature représentait des dangers de mort en toute saison. En hiver, le manteau neigeux, devenu instable, était à l’origine d’avalanche, un fait peu connu encore. Le préfet des Hautes-Pyrénées l’explique dans un rapport :
« Un phénomène également remarquable, et qui se présente assez fréquemment dans les Pyrénées, est la chute inattendue et comme instantanée d’une masse d’eau ou de neige qui roule du sommet des monts dans les vallées, avec un facs et souvent des dégâts épouvantables. On nomme ce phénomène « avalanche » ou « lavange ». » [3]
Au printemps, la fonte des neige, ou en été les violents orages généraient des « lavanges » de boue. Les digues construites pour éviter ces inondations et rendre cultivables des champs proches des cours d’eau s’avéraient trop rares pour endiguer les flots :
« Au moindre orage, les torrens [sic] grossissent considérablement, et pour peu que la pluie dure, ils grondent comme la foudre [le tonnerre], entraînent avec fracas des rochers énormes du sommet des montagnes, renversent tout ce qu’ils rencontrent; et, sortant souvent de leur lit déjà trop étendu, ils menacent les habitations, les villages, et couvrent les environs de ruines et de débris ». [4]
Les animaux sauvages et carnassiers étaient redoutés, en tout premier les meutes de loups. Le colonel comte Charles d’Agoult dont la famille possédait une propriété dans les Alpes note dans ses souvenirs de jeunesse la belle frayeur que ressentit le régisseur du domaine une nuit de 1804 :
À Chanousse, l’épicier, le boulanger et le boucher étaient un luxe inconnu. Il fallait traverser un passage très élevé qui n’est fréquenté que par quelques pâtres et par les loups. Le jour, on ne rencontrait jamais de ces hôtes fâcheux, mais, la nuit, la route était moins sûre. Haber [le concierge du château], lent et rusé comme un montagnard dauphinois, n’en finissait jamais et, de plus, aimait la bouteille. Un jour donc qu’il était allé à Serre, l’heure du retour était déjà passée, et point d’Haber. Sa femme jetait les hauts cris. Mon père, pour la rassurer, envoya un des garçons de ferme à la rencontre du voyageur. Nous attendîmes avec une certaine anxiété. Enfin, il arriva, calme à son ordinaire, mais très pâle. Il nous raconta que, parti un peu tard de la ville, il était arrivé au col de la montagne à la nuit et qu’il avait été suivi par plusieurs loups. S’il avait hâté le pas ou s’il était tombé, il était un homme perdu ; mais, armé de son gros bâton, il continua le plus dangereux sans être attaqué. Les loups disparurent, et alors il doubla le pas ». [5]
Une agriculture de survie
Le sol peu fertile, lavé par de trop fréquentes eaux torrentielles, devait toutefois produire des céréales ou des plantes « à farine » (comme le sarrasin) pour assurer le maintien des populations, et ce rapidement car la bonne saison était courte. Le froment était cultivé en priorité, puis le seigle et l’orge. La rareté du fumier et l’habitude de cultiver toujours les mêmes cultures sur les mêmes champs appauvrissaient les sols. Dans les Hautes Alpes, la rotation des cultures qui aurait permis d’enrichir la terre et la création de prairies artificielles d’herbes à fourrage ne parvenaient à s’imposer chez des agriculteurs qui préféraient conserver les méthodes jugées « sûres » de leurs pères. Le foulage des grains immédiatement après la moisson par des bœufs ou des chevaux était source de perte considérable de grains et de saleté. L’absence de grange pour entreposer les récoltes, qui ainsi pouvait attendre au sec la mauvaise saison avant d’être battue au fléau, explique cette précipitation et la nécessité d’utiliser les animaux de labour pour aller rapidement. Ce procédé malheureusement ne faisait que diminuer des récoltes déjà maigres. La paille obtenue était trop écrasée et mêlée à de la poussière pour être donner telle quelle aux animaux. Il fallait la mélanger avec l’herbe des regains pour lui donner une consistance.
Les cultures de légumes ou de colza pour l’huile d’éclairage étaient circonscrites au jardin potager. La pomme de terre qui s’acclimatait si bien aux régions montagneuses avait fait son apparition dans les enclos particuliers et sur les tables des familles, mais sa culture se limitait encore à cet espace, et n’était pas étendue au plein champ, limitant de fait les récoltes.
Les bêtes de ferme se limitaient à quelques vaches et chèvres, et aux poules et coqs de la basse-cour. Il était difficile de posséder de nombreuses têtes dans un espace pauvre en herbe et dans un climat qui faisait enfermer le bétail plus de la moitié de l’année, ce qui nécessitait de grandes réserves de fourrage.
Réunis en d’immenses troupeaux, les moutons suivaient les routes bien connues de la transhumance. Un berger ou plusieurs bergers étaient chargés par les propriétaires des plaines de monter les bêtes aux pâturages d’été près des sommets. Cet usage jugé immémorial apportait de l’argent pour les petits agriculteurs alpins qui louaient leurs près. Ce numéraire permettait de payer les impôts et les produits non confectionnés à la maison. Les bergers formaient un groupe à part des agriculteurs. Dans le département du Mont-Blanc, on les appelait les « Boujus ». Ils vivaient en communauté, à côté du monde des agriculteurs. Et contrairement à ces derniers, ils ne pratiquaient pas l’immigration saisonnière. Ils sculptaient des ustensiles en bois qu’il portaient vendre à Chambéry ou Annecy :
Les ménages sont soumis à l’administration d’un seul, qui agit, achète et vend pour la communauté ; ce n’est pas toujours le plus âgé, mais le plus capable. L’administration intérieure est confiée à une femme, qui est rarement celle du chef. Un troisième personnage, qu’on appelle le Suisse est chargé du soin du bétail, ainsi que de surveiller la fabrication des fromages, qui forment une des branches importantes du revenu. J’eus occasion, au mois de germinal an II (avril 1803) de visiter une ferme de ce genre près de la chartreuse d’Aillon ; elle se composait de trente-trois individus. J’avais trouvé les enfants dans une vaste cuisine : le foyer commun est d’une grandeur proportionnée aux nombreux ménages. J’entrai ensuite dans une chambre voisine, où les grandes personnes étaient à table : il y régnait un profond silence : les femmes étaient placées toutes de file à l’un des bouts, et les hommes à l’autre. Tout respirait l’aisance et la propreté. [6]
La chasse, un complément alimentaire et une fierté d’homme
Le gibier était abondant dans les forêts et les escarpements rocheux. Certaines proies étaient particulièrement recherchées pour leur rareté et donc leur valeur : la grive de Maurienne, nommée également « Genevrière » gardait après la cuisson le parfum des graines de genévriers dont elle se nourrissait ; le grand tétras ou coq de bruyère qui se cachait au fond des bois devait être surpris à la pointe du jour ; le bouquetin aperçu après une course sur les sommets pouvait acculer le chasseur à un rocher et le presser à l’étouffer. Le récit des exploits cynégétiques était conté à l’envi autour des tables familiales et pour le voyageur de passage, surtout quand le gibier était terrifiant :
Quoique l’ours des Pyrénées soit moins gros et moins vigoureux que celui des Alpes, sa chasse offre quelques dangers : aussi est-elle le sujet des entretiens des montagnards, et chacun se plaît à écouter le récit des prouesses des chasseurs les plus intrépides. Celui qui s’exerce à cette chasse est couvert de trois peaux de mouton garnies de leurs poils : si les balles dont son fusil est chargé n’ont point abattu l’animal, il doit attendre avec fermeté, se laisser saisir sans redouter ses ongles robustes, et lui ouvrir le ventre avec le poignard dont il est armé. [7]
Des industries rares, une activité artisanale parfois insuffisante
L’isolement de l’habitat, les sentiers et les routes rendus impraticables une bonne partie de l’année ne favorisaient pas le développement de fabriques, excepté dans les vallées. Ainsi des villes comme Annecy accueillait des ateliers de filage et de tissage de coton. Ces établissements ouverts toute l’année fixaient une population jeune, hommes et femmes. Les « gros employeurs » des régions de montagne étaient les gisements miniers : houille, cuivre, plomb. Les conditions de travail étaient physiquement éprouvantes. Les mineurs, à l’instar des bergers, restaient à part, formant des communautés isolées.
L’industrie dans les hautes vallées relevait de l’artisanat basé sur les objets en bois, en fer (ateliers de clouterie), ou utilisant de la laine (draps, vêtements). Les produits de cette industrie domestique et familiale étaient vendus directement à des colporteurs pour leurs tournées, ou confiées à un homme du village qui descendait dans les vallées et était chargé de les négocier. Certaines communautés villageoises avaient parfaitement organisé le processus de commercialisation. Ainsi dans le canton de Saillagouse dans les Pyrénées orientales, les bas de laine tricotés durant l’hiver étaient descendus durant l’été par la voie du roulage dans différents entrepôts parfois très éloignés (Lyon, Nîmes, Grenoble et Nice). En octobre suivant, les hommes rejoignaient les plaines et devenaient colporteurs. Ils allaient chercher la marchandise dans les entrepôts et sillonnaient les départements des Cévennes jusqu’en Alsace.
La fabrication des fromages occupait beaucoup d’agriculteurs et de bergers, même si, selon une description contemporaine, ce type de production ne servait qu’à la nourriture des cultivateurs et à celle de la classe la moins fortunée des habitants des villes. À l’exception des fromages persillés, les autres fromages étaient peu estimés, jugés « fort communs ». [8]
Des migrations temporaires indispensables
Cependant ces activités aussi nombreuses et diverses soient-elles n’apportaient que de maigres ressources. Les paysans devaient aller chercher à l’extérieur un complément de revenus, en louant leurs bras ou leurs savoirs pour quelques semaines ou quelques mois par an. Ce procédé était également un moyen de résoudre les problèmes de surpeuplement rural. On peut classifier ces migrations selon les saisons de l’exil. Les migrations de l’hiver, d’octobre à mars-avril, concernaient les hommes qui partaient pour exercer des petits métiers manuels et le petit commerce du colportage. Ils suivaient des courants migratoires anciens, aux tracés pré-établis depuis des générations et à destination de pôles d’attraction urbains, notamment Paris et Lyon. Les jeunes gens et les enfants partaient ramoner les cheminées au tout début de la mauvaise saison. Même si l’on doit souligner que le terme de Savoyard pour désigner un ramoneur était générique et englobait tout aussi bien des migrants venus d’autres régions, en particulier du Massif central.
Le degré élevé d’alphabétisation de certaines vallées alpines (Briançon, Barcelonnette) était une réalité très étonnante aux yeux des visiteurs. Un petit pâtre sachant lire et écrire était inhabituel dans un pays où le taux d’illettrisme avoisinait 73% pour les hommes et 66 % pour les femmes au début de l’Empire. Ce savoir acquis au cours des veillées auprès des aînés ou dans des écoles communales largement ouvertes à tous, étaient à l’origine (ou était-ce une conséquence ?) d’une migration singulière : celle des hommes-instituteurs. Descendus après les moissons, les hommes parcouraient les marchés des plaines de Provence en quête d’une place d’enseignant durant l’hiver. Une plume à leur chapeau signifiait qu’ils pouvaient enseigner la lecture et l’écriture. Deux plumes indiquaient que la science du calcul pouvait aussi être dispensée.
Les migrations estivales succédaient aux migrations hivernales. Elles consistaient principalement à la participation aux travaux des moissons et les vendanges. Il semble que les individus qui pratiquaient ces « missions extérieures » plus courtes n’étaient pas les mêmes que ceux qui partaient pendant de longs mois en hiver. Bien que peu d’études s’attachent à définir quels étaient les groupes de migration qui partaient pour telle ou telle destination et à quels moments, on peut avancer que les phénomènes de migrations dans la haute montagne variaient selon plusieurs critères. Parmi ces critères, on peut citer les habitudes villageoises qui variaient d’un bourg à l’autre : le métier de colporteur se transmettait de père en fils dans tel hameau, alors que dans le hameau voisin, l’embauche chez les mêmes artisans des plaines se renouvelait tous les ans. Il faut également tenir compte des traditions au sein de la famille : on préférait parfois faire partir le cadet plutôt que l’aîné qui devait assurer la continuité sur la propriété et rester en dehors du danger du monde. L’âge du départ devait également entrer dans les calculs des familles : les travaux de moisson ou de vendange dans les plaines du Rhône avaient le mérite de la proximité et permettaient peut-être de « dégrossir » les jeunes gens avant une migration plus longue. Il n’était pas rare que les déplacements d’été se fassent en famille. Les enfants accompagnaient leurs parents, père et mère, et étaient chargés de lier les gerbes.
En 1807, le gouvernement impérial demanda aux préfets des statistiques sur les migrations saisonnières. Cette enquête visait à évaluer l’ampleur du phénomène migratoire, pour des motifs économiques mais peut-être aussi pour des raisons militaires. En effet, l’absence de nombreux jeunes gens partis travailler au loin était constatée régulièrement lors du tirage de la conscription. La migration permettait ainsi d’échapper au service des armes. Les statistiques les plus complètes furent fournies par les Hautes-Alpes. Il reste très instructif sur les métiers exercés par les montagnards [9] :
| Profession | Briançon | Embrun | Gap | Total |
| Instituteurs | 601 | 69 | 35 | 705 |
| Colporteurs | 593 | 204 | 331 | 1128 |
| Peigneurs de chanvre | 151 | 10 | 340 | 501 |
| Bergers | 142 | 45 | 58 | 245 |
| Cultivateurs | 134 | 144 | 191 | 469 |
| Marchands de fromage | 244 | 4 | 8 | 256 |
| Mégissiers | 28 | 28 | ||
| Charcutiers | 388 | 68 | 15 | 83 |
| Aiguiseurs | 16 | 40 | ||
| Voiturier | 16 | 9 | 25 | |
| Porteurs de marmottes | 6 | 6 | ||
| Divers | 93 | 81 | 295 | 469 |
| Total | 2374 | 663 | 1282 | 4319 |
Des maladies et des malformations
Les migrations saisonnière permettaient également de varier et d’enrichir une alimentation qui restait peu variée. Composée essentiellement de pains grossiers et viandes très salées pour être conservées, elle entraînait des carences sources de maladies et de malformation. Le rachitisme était diffus et présent un peu partout, en campagne comme en ville. Les causes en étaient la rareté du soleil, mais aussi les habitudes d’emmailloter les nourrissons, de tenir cloîtrer les jeunes enfants quand les parents travaillaient à l’extérieur, de baser les repas sur des bouillies de châtaignes et de maïs engendraient des êtres malingres, et parfois difformes.
La présence de nombreux goitreux et le crétinisme qui allait de pair pour certains d’entre eux dans les « vallées profondes » sont attestés par de nombreux voyageurs. Au Premier Empire, les médecins commençaient tout juste à entrevoir les méfaits d’une alimentation trop pauvre en iode et ses effets sur la glande thyroïde. Mais la plupart des praticiens en étaient encore à mettre en accusation l’absence de vent pour aérer l’atmosphère ou une eau porteuse de la maladie.
Les refroidissements, les pneumonies, les rhumatismes étaient le lot de bien des habitants. Une coutume bien ancrée voyait dans les boissons qui chauffaient et faisaient suer le corps le meilleur moyen de guérir : la sauge, le génépi, le poivre, le gingembre étaient mis à infuser dans le vin.
Le manque flagrant d’hygiène de certaines maisons « altérait à la longue les plus forts tempéraments » : il arrivait que pendant l’hiver, les habitants couchaient dans les écuries sur trois ou quatre pieds de fumier ! Les draps, une paire unique, avaient droit à un lavage spécial et expresse : on se contentait de les exposer à la gelée pour détruire les insectes.
Des vêtements chauds et résistants
Les pantalons, chemises, jupes et corsages étaient souvent fabriqués soit à la maison avec la toison des moutons lavée et filée, soit par un tisserand du village qui exécutait les commandes. Les femmes et les enfants avaient gardés l’habitude de porter des corsets. Cette habitude était jugée nocive par les médecins qui stigmatisaient les effets funestes sur les poumons comprimés toute la journée. La froidure des jours d’hiver était combattue par des gilets de peaux de moutons et des bonnets de laine sous les chapeaux. Aux jours de fêtes, les femmes portaient des vêtements égayés par des rubans de couleur. Ceux-ci prenaient une signification bien particulière sur les robes des mariées : ils étaient placés horizontalement en bas de la robe, et leur nombre indiquait le montant de la dot !
Fêtes et divertissements
Les fêtes étaient presque toutes religieuses : chaque paroisse avait son patron. Le matin, les fidèles se réunissaient dans l’église, et l’après-midi, une « vogue », c’est-à-dire une foire, s’établissait sur la place, ou près du cimetière ou encore en plein champ. Des colporteurs étalaient leurs marchandises et leurs provisions de bouche. Les joueurs de violon, payés au morceau, faisaient danser la jeunesse. Les parents et grands-parents étaient attablés autour de verres de vin, de pain et de fruits. Des concours d’adresse et des jeux étaient organisés. Des petites pièces de théâtres étaient jouées sur des tréteaux plantés en plein champ : les rôles étaient tenus par les villageois eux-mêmes qui reprenaient des classiques du répertoire français mais traduits en patois et avec leur accent.
Les pèlerinages avaient pour but une guérison ou la réalisation d’un vœu. La date des processions répondait au calendrier des saints. Ces journées d’exception cassaient le rythme routinier des travaux des champs et se concrétisaient par des rassemblements qui tenaient à la fois de la piété religieuse et de la ferveur ancestrale aux pouvoirs surnaturels :
« Assez souvent de petites chapelles se trouvent bâties auprès de certaines sources auxquelles on attribue des vertus spécifiques ; on s’y rend en dévotion à certains jours de l’année, et quand on s’y croit oublié par des maladies qu’elles ont la réputation de guérir ; on y boit quelques verres d’eau, on s’en lave les yeux ou d’autres parties malades ; on dépose ensuite une offrande dans un tronc, ordinairement placé près du buste ou de l’image du Saint vénéré ; et après qu’on a fait tout cela, on s’en retourne chez soi, avec de l’espoir que l’on sera bientôt guéri ». [10]
L’isolement des haute vallées dû aux conditions géographiques et climatiques s’atténua au fil du XIXe siècle grâce à l’amélioration du réseau routier, à l’accroissement des visiteurs durant l’été à la recherche de paysages grandioses et au développement des activités de cures thermales. Les migrations saisonnières en furent facilitées, au point que pour nombre de candidats et de candidates au départ, elles se transformèrent en exode rural durable.
Chantal Prévot, 2010
Responsable des bibliothèques à la Fondation Napoléon, Chantal Prévot est également auteur d’articles et de livres sur l’histoire de Paris, sur la vie quotidienne sous les deux Empires, et de manière plus spécifique d’études sur le testament et le masque mortuaire de Napoléon Ier. Elle a écrit en 2010 un ouvrage sur les Les paysans de Napoléon. Aspects de la vie quotidienne et mentalités (éd. Soteca).
Notes
[1] « Des influences du climat et du sol sur le caractère des peuples, par le citoyen Canolle, médecin », dans Analyse des travaux de la Société d’émulation de Poitiers pour l’an 1803, Poitiers, Catineau, 1803, p. 18
[2] Bonnaire, citoyen, préfet, Mémoire au Ministre de l’intérieur sur la statistique du département des Hautes-Alpes, Paris, 1800, p. 2.
[3] Laboulinière P., Annuaire statistique du département des Hautes-Pyrénées, Tarbes, Lavigne, 1807, p. 116.
[4] Bonnaire, citoyen, préfet, Mémoire au Ministre de l’intérieur sur la statistique du département des Hautes-Alpes, Paris, 1800, p. 3.
[5] Agoult, Charles, Mémoires., Mercure de France, 2001, p. 41.
[6] VERNEILH (M. de), Statistique générale de la France, Département du Mont-Blanc, Paris, Testu, 1807, p. 47.
[7] Millin de Grandmaison, Aubin-Louis, Voyage dans les départements du midi de la France, Paris, impr. impériale, 1807-1811, tome IV, p. 547.
[8] Bossi, Statistique générale de la France, département de l’Ain, Paris : Testu, 1808, p. 350.
[9] Cité par : HOUDAILLE, Jacques, Les migrations temporaires au début du XIXe siècle [article] Dans : Population, Année 1972, Volume 27, Numéro 6, pp. 1140-1143.
[10] VERNEILH (M. de), Statistique générale de la France, Département du Mont-Blanc, Paris, Testu, 1807, p. 300.