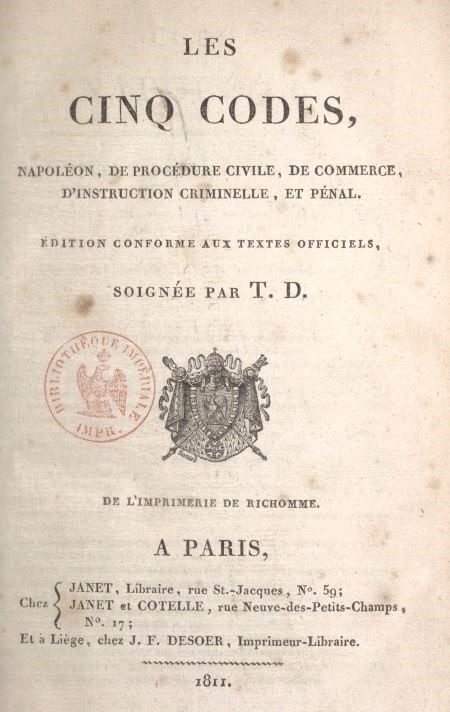Napoléon considérait la règle de droit comme un outil essentiel de la structuration sociale, idée qui nous paraît aujourd’hui aller de soi. Mais il n’est pas inutile de le souligner pour l’époque qui nous concerne car depuis la Révolution, souvent vue comme le règne de la philosophie, la catégorie des juristes avait perdu de son aura et de sa crédibilité. Rien de tel sous le Consulat et l’Empire, bien au contraire : les juristes tinrent le haut du pavé. Cambacérès, numéro deux du régime, et tant d’autres sont là pour le rappeler. Par ailleurs, en matière de lois structurantes, le régime napoléonien est à créditer d’une œuvre colossale : la codification du droit français, avec bien sûr le Code civil (1804, rebaptisé « Code Napoléon » en 1807) mais aussi les Codes de procédure civile (1806), de commerce (1807), d’instruction criminelle (1808), pénal (1810), sans oublier l’ambitieux projet de code rural qui, bien que prêt à la fin du règne, ne vit pas le jour.
La codification : pierre angulaire de l’ordre social
« Toute entreprise de codification, pour réussir, requiert trois conditions : un moment favorable, des juristes de talent, une volonté politique », a écrit Robert Badinter dans « Le plus grand bien… », un essai sur le Code civil (Fayard, 2004). Ces conditions furent remplies sous le Consulat et l’Empire. Dans cette vaste démarche, le rôle du chef de l’État fut essentiel : avec lui, la volonté politique n’était pas faible. Il bénéficia certes des travaux antérieurs et de la collaboration d’immenses juristes (Cambacérès, Target, Treilhard, Tronchet, Bigot de Préameneu, Malleville, Portalis, etc.). Mais il paya aussi de sa personne lors des nombreuses séances du Conseil d’État auxquelles il assista, notamment lors des travaux préparatoires au Code civil. S’il ne tint pas la plume, s’il ne rédigea rien par lui-même et si même, à de nombreux égards, il n’avait sur les détails juridiques que des idées vagues, il fut celui qui rendit possible le vieux rêve codificateur. A contrario, son absence d’implication dans l’avancée du projet de code rural explique peut-être pourquoi celui-ci n’aboutit pas, alors que des centaines de pages avaient été noircies, que chaque département avait créé une commission de réflexion et que le texte était quasiment prêt en 1814.
La volonté de codifier s’inscrivait parfaitement dans les principes (théorisés avec force par la Révolution) d’unité et d’indivisibilité de l’État en France. Sur le plan pratique, son premier objectif était de simplifier la « marqueterie de l’ancien droit » (Jean-Louis Halperin), qui avait fait dire à Voltaire que lorsqu’on voyageait à son époque, on changeait aussi souvent de lois que de chevaux de poste. Sur le plan technique, le regroupement des textes facilitait leur connaissance et leur publicité. Et comme les textes étaient écrits dans un français parfait et étaient généralement courts (nos législateurs devraient sans doute mieux s’en inspirer), désormais nul ne serait plus sensé ignorer la loi. Sur le plan de la philosophie juridique, la codification consacrait le triomphe du droit écrit sur les coutumes caractéristiques de l’ordre juridique de l’Ancien Régime. Mais c’est sur le plan politique que l’entreprise prenait tout son sens : plus qu’une conception du droit, on imposait une vision de la société. On ne compilait pas, mais on construisait en réformant, on ordonnait en asseyant les institutions et en faisant entrer dans l’armature de la société des options idéologiques. Le Code civil reste évidemment l’exemple parfait de cette démarche, mais on la retrouve aussi dans le Code de commerce et, à un niveau moindre, dans le Code pénal de 1810.
On exagère à peine si l’on écrit que la codification du droit français était inscrite dans les buts du coup d’État qui avait porté Bonaparte aux affaires : voici les circonstances favorables dont parle Badinter. L’article 14 du décret du 19 brumaire an VIII créant le Consulat provisoire stipulait en effet : « Les [deux commissions législatives provisoires qui remplaçaient les conseils mis en congés] sont chargées de préparer un Code Civil », preuve que les brumairiens considéraient que la stabilisation de la société et de la Révolution passait par l’aboutissement de l’ouvrage tant de fois commencé et tant de fois remis depuis dix ans. C’est alors que Napoléon entra en scène à sa façon, exigeant que l’on aille vite et que l’on aboutisse enfin. Quatre années de travail furent encore nécessaires avant que le 21 mars 1804, les 36 lois constituant le Code civil des Français fussent promulguées. La voie était ouverte à la généralisation du processus de codification.
Un Code inspiré par l’expérience
« Le peuple a besoin de magistrats fermes et qui sachent lui inspirer de la crainte », écrivait Napoléon, un jour de juin 1805. Le grand chantier de l’organisation judiciaire, ouvert par la Révolution et amplifié par le Directoire, connut une nouvelle accélération sensible dans les mois qui suivirent Brumaire. Les directions de travail données aux législateurs furent simples : comme les justiciables n’avaient plus confiance en des tribunaux lents, partiaux et en trop petit nombre, il fallait, d’une part, revoir le maillage du territoire et, d’autre part, affermir les compétences personnelles des magistrats en revenant sur le principe de leur élection. Ces grands principes de l’organisation judiciaire et l’inamovibilité des juges furent inscrits dans la constitution, aux articles 60 à 68.
Alors même que le travail sur le Code civil battait son plein, Napoléon décida qu’il fallait sans attendre travailler à d’autres projets, à commencer par le complément indispensable au premier ensemble : un Code de procédure civile permettant de fixer les formes d’établissement des actes civils et d’arbitrage judiciaire des différends entre citoyens. Une commission fut nommée en mars 1802. Comme on l’avait fait pour le Code civil et comme on allait le faire pour les autres codes, les projets issus de la commission circulèrent largement (et officiellement) au sein du corps des magistrats qui purent ainsi donner leur avis. On a donc tort de penser que les codes napoléoniens sont « tombés » du haut de l’État sur les juges et les justiciables. Seuls les principes philosophiques généraux étaient fixés par les quelques spécialistes des commissions.
Pour le code de procédure civile, le travail reposa sur les épaules de Treilhard. Il fut assisté du jurisconsulte Pigeau qui, sous l’Ancien Régime, avait publié une Procédure civile du Châtelet de Paris et de toutes les juridictions ordinaires du Royaume. Il sortit de ces réflexions et échanges un texte proche par bien des aspects de l’ordonnance de Lamoignon de 1667 et qui « tournait complètement la page de l’épisode révolutionnaire […] visant l’idéal jamais atteint de toute justice (simplicité, rapidité et gratuité) en s’efforçant de réduire le procès à sa plus simple expression » (Jean-Claude Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, 2001). La promulgation intervint les 24, 27 avril, 2, 8, 9 mai 1806. Le code fut complété par de nombreux décrets dont ceux signés sur le champ de bataille d’Eylau, en février 1807, sur les frais et dépens judiciaires..
Sans s’en désintéresser, Napoléon participa peu au travail de la commission ad hoc et du Conseil d’État où il ne vint siéger qu’une fois, le 22 février 1806, sur vingt-trois séances consacrées à cet objet. Mais il est vrai que la matière était aride et technique, ne réclamant que peu d’interventions politiques. Le cas échéant, Cambacérès pouvait intervenir directement. Selon le secrétaire du Conseil d’État, Locré, les conseillers eux-mêmes ne se passionnèrent pas pour cette question que la plupart d’entre eux « n’entendaient pas ». Treilhard et, surtout, Pigeau en furent les véritables pères du texte.
Le Code de procédure civile était organisé en deux parties. La première traitait de la procédure devant les tribunaux en cinq livres : de la justice de paix (I), des tribunaux inférieurs (II), des tribunaux d’appel (III), des voies ordinaires pour attaquer les jugements (IV), de l’exécution des jugements (V). La deuxième, « Procédures diverses », organisait, en trois livres, les offres de paiement et la consignation, le droit des propriétaires, etc. (I), les procédures relatives à l’ouverture d’une succession (II) et les arbitrages (III).
La première partie conservait donc l’organisation judiciaire en matière civile, organisée en quatre niveaux : juges de paix, tribunaux de première instance (dits « inférieurs » par le code), cours d’appel et Cour de cassation. Cette grille ne remettait pas en cause celle définie par les lois du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801) et du 28 floréal an X (18 mai 1802). L’organisation générale de cette justice de droit commun restait calquée sur le découpage administratif en cantons, arrondissements et départements. Le juge de paix siégeait au chef-lieu de canton et réglait les petits différends entre particuliers. L’institution était maintenue, mais au prix d’une réforme fondamentale du mode de désignation de ce magistrat de proximité (nomination pour dix ans et non plus élection). Au-dessus des juges de paix, les tribunaux de première instance siégeaient au niveau de l’arrondissement (soit environ 400 tribunaux) et les tribunaux d’appel (devenus « cours impériales » et leurs magistrats « Conseillers de Sa Majesté », en 1804) au niveau d’un groupe de deux ou trois départements. Comme aujourd’hui, la Cour de cassation examinait la régularité juridique des jugements sans, en principe, se pencher sur le fond.
La matière du Code de procédure civile était extrêmement précise, complexe et très adaptée à son époque. Les spécialistes de la matière estiment qu’elle était peu novatrice au fond et que les rédacteurs s’étaient souvent contentés de reprendre des solutions venues tout droit de l’Ancien Régime. Il serait fastidieux d’entrer ici dans les détails. Ce qu’il faut en retenir est que l’ensemble des procédures était unifié et préétabli. Les justiciables savaient où ils allaient en demandant aux tribunaux de trancher leurs différends. Il en allait de même pour les magistrats dont le travail était encadré par des règles précises.
La justice, priorité du gouvernement impérial
La proximité, l’indépendance des magistrats par rapport aux intérêts privés (sinon par rapport au pouvoir) et la rationalisation des procédures étaient renforcées. Napoléon voulait aussi rendre son lustre et sa majesté à la justice : la robe avait fait sa réapparition aux audiences et, progressivement, les juridictions s’installaient dans de prestigieux bâtiments. L’État leur donnait en outre les moyens de leur mission. Avec un budget oscillant selon les années entre 20 et 28 % des dépenses civiles de l’État et 3 à 4 % des dépenses totales, la justice était assez bien lotie. Cela ne veut pas dire qu’elle employait une foule de magistrats, bien au contraire. La pénurie de compétences freinait le recrutement et une administration satisfaisante. Les investissements et les aménagements des bâtiments pesaient sur les dépenses. Mais comparé à celui des régimes qui l’ont précédé, le bilan du régime napoléonien n’en est pas moins positif.
À sa place dans la chronologie et dans l’histoire, la construction judiciaire consulaire puis impériale participe à l’évolution des pratiques et des règles en la matière, après les siècles d’inégalitarisme de l’Ancien Régime et les années de tâtonnements révolutionnaires. Si elle ne pouvait par définition répondre aux critères qui, par étapes parfois douloureuses, présidèrent par la suite et président aujourd’hui aux systèmes judiciaires modernes, elle fut pérenne dans sa structure et ses grands principes. Certes, le Code de procédure civile n’eut pas le même succès et la même pérennité que le Code civil. Mais il fallut tout de même attendre 1934 pour en voir la réforme en profondeur. A l’exception de quelques dispositions sur les voies d’exception, les derniers vestiges de l’œuvre de 1806 ont disparu en 1976, avec la promulgation du nouveau Code de procédure civile.
Ce n’est pas un poète du XIXe siècle mais un juriste du nôtre, Jean-Pierre Royer, qui écrit : « Le temps sera pratiquement sans prise sur l’édifice. « Coulé en bronze », il restera à l’abri des grosses tempêtes des siècles, le « fleuve majestueux » de la justice reprendra son cours ordinaire après les brisures de la décennie révolutionnaire ». Pour le reste, on ne saurait bien sûr se contenter de lire les textes et prétendre que le régime napoléonien instaura en toutes circonstances un État de droit, garantit en tous lieux les droits de la défense ou l’indépendance des magistrats. Le recours aux juridictions d’exception ou le contrôle tatillon de la profession d’avocat –ce « tas de bavards artisans de révolutions » à qui il faudrait pouvoir « couper la langue », selon l’empereur- obèrent le bilan de la politique juridictionnelle de l’époque.
Thierry Lentz, directeur général de la Fondation Napoléon
Mise en ligne : 30 janvier 2024