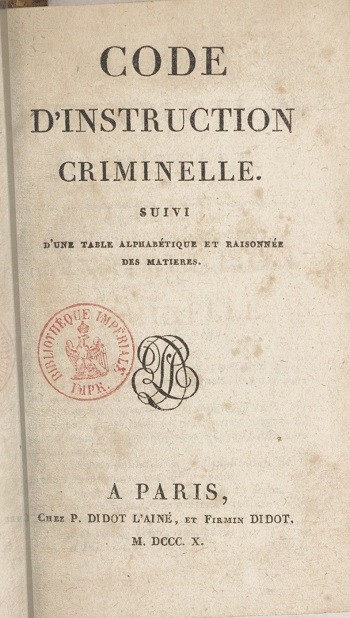La question de la procédure criminelle constitue l’une des clés de la contestation du régime monarchique en 1789. Bien que l’ordonnance royale d’août 1670 ait constitué une remarquable œuvre de codification, destinée tant à la rationalisation du système criminel qu’à la lutte contre les abus et dysfonctionnements générés par le système coutumier, demeurent les incontestables écueils de la procédure d’instruction reposant en grande partie sur l’arbitraire des magistrats et sur la cruauté du système des différentes questions.
La seconde partie du XVIIIe siècle sera aussi l’occasion de nombreuses affaires judiciaires révélatrices des failles de la procédure qui aboutirent à l’implication politique de certains grands penseurs du temps dont les principes humanistes trouvèrent alors le terrain propice à l’expression de leur contestation. L’affaire Calas en 1761, puis l’affaire Sirven en 1764 ne feront qu’ouvrir la danse des scandales judiciaires qui émailleront la fin du règne de Louis XV et celui de Louis XVI. À cela s’ajoutera le débat suscité par la parution du Traité des délits et des peines du jeune Milanais Beccaria en 1764 qui, grand lecteur de Montesquieu et des philosophes français, fustigera la procédure criminelle et sera de ce fait porté aux nues par les plus grands dont Voltaire.
Le règne de Louis XVI sera l’occasion de l’abolition de certains abus comme la question préparatoire (1780) ou la question préalable (1788), ainsi que la consécration de certains principes comme celui de la motivation des sentences (1788). Mais cette politique, qui dans certains cas anticipa de quelques jours la convocation des États généraux par le Conseil, d’humanisation de la procédure criminelle n’empêchera pas que la procédure pénale soit au cœur des critiques avancées par les cahiers de doléance. L’exigence de disparition de la torture (pourtant amorcée par les réformes de 1780 et 1788), le désir de voir développé le conseil, la question de la motivation des décisions, celle de la disparition des lettres de cachet, l’apparition des jurys dans la procédure, sont autant de réclamations formulées en 1789, probablement sous l’influence de publicistes, qui ne seront pleinement réalisées qu’avec la codification de 1808.

Les précédents du droit intermédiaire
La période révolutionnaire et le droit intermédiaire en découlant seront propices à une vaste réflexion sur la question criminelle, aidée par les compétences poussées des membres des différentes assemblées intervenues sur le sujet. Ils sont l’occasion d’un laboratoire procédural débouchant sur quelques textes majeurs qui conditionneront la rédaction du Code d’instruction criminelle de 1808, comme sources d’inspiration mais surtout comme repoussoir.

D’un Comité pour la réforme de la jurisprudence criminelle, composé de membres illustres comme Thouret, son rapporteur, Tronchet ou Target, naîtra la loi des 8 octobre et 3 novembre 1789 portant réforme provisoire de la jurisprudence criminelle. A cela s’ajoutera la réforme des juridictions pénales amorcée en 1790. Mais c’est surtout les lois des 16-29 septembre 1791 et 29 septembre – 21 octobre 1791 qui organiseront la procédure criminelle en instaurant notamment le pouvoir considérable du juge de paix et s’appuyant sur le jury populaire comme acteur essentiel du jugement.
Le juge de paix, élu du peuple, devient en effet la clé de voûte du système de l’instruction puisque le juge d’instruction n’intervient désormais qu’à sa demande, qu’il ait été saisi par des particuliers ou qu’il se soit saisi d’office. La dénonciation civique devient ainsi le pilier de la procédure, associée à l’idée qu’elle correspond à un acte de responsabilité citoyenne.
La procédure criminelle devient donc une chose publique, illustration de l’appropriation par le souverain, le peuple, du fonctionnement de la machine étatique. Celle-ci n’est plus dans les mains du pouvoir étatique autonome, l’accusateur public et le commissaire du roi, ancêtres de notre procureur, ne pouvant pas se saisir en dehors de l’impulsion du juge de paix. L’action publique n’existe plus en tant que telle.
L’appropriation populaire de la procédure pénale se retrouve alors à tous les stades de celle-ci. Elle se matérialise par l’intervention à deux niveaux du jury, sous la forme d’un jury d’accusation, tout d’abord, chargé de l’admission ou du refus de celle-ci, puis sous celle d’un jury de jugement qui, sous l’empire de son intime conviction décide de reconnaître ou non la véracité des faits justifiant une condamnation. Les juges statuent par la suite sur la peine à appliquer en cas de reconnaissance de la culpabilité par les jurés.
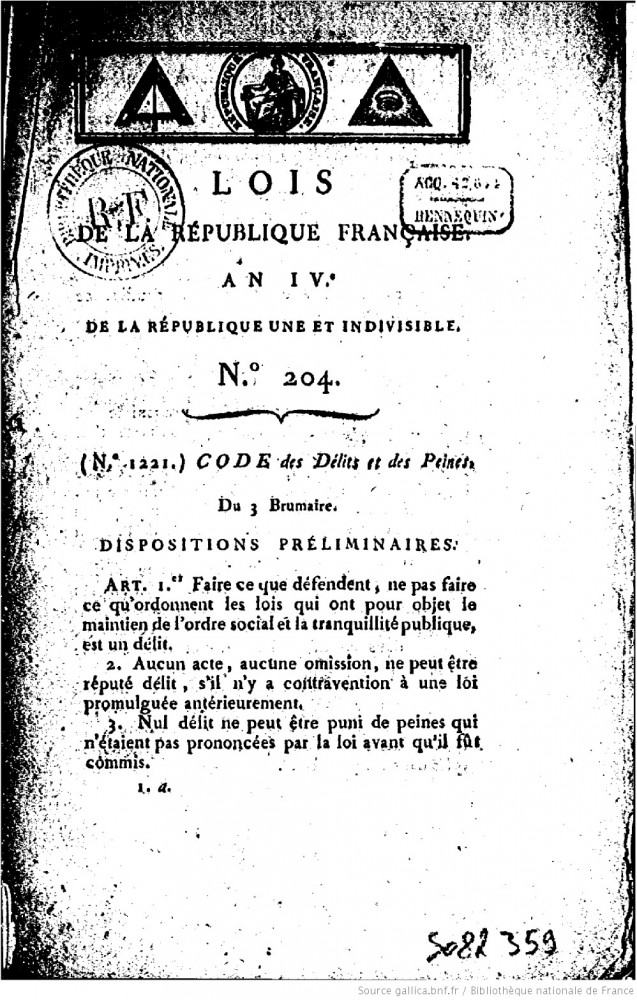
Par la suite, deux textes vinrent modifier cette procédure. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), rédigé par Merlin de Douai, n’a pas bouleversé le système issu des lois de 1791. Il a cependant limité le droit détenu par les particuliers de provoquer la poursuite criminelle. Si le principe de dénonciation civique demeure, ce n’est cependant pas pour permettre aux citoyens une saisie directe du jury d’accusation.
Le juge de paix peut être saisi, demeurant néanmoins libre de poursuivre ou non la personne accusée. Mais surtout, les premiers articles du texte de l’an IV rappellent la distinction entre action publique et action civile, entre la poursuite des atteintes portées à l’ordre social, exercée par l’État au nom du peuple souverain, et la recherche de la réparation des dommages causés au particulier. Ces articles tendent ainsi à la restauration d’un ministère public qui sera rétabli par la loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801).
Cette première grande réforme pénale du Consulat est un écho aux dispositions pénales de la Constitution de l’an VIII qui a installé un accusateur public en la personne du Commissaire du gouvernement auprès de chaque tribunal criminel de département (art. 63). Cette loi donne à chaque Commissaire du gouvernement des substituts dans chaque arrondissement. Ils tiennent le rôle de procureur de la République, chargé à ce titre de la police judiciaire, de la recherche jusqu’à la poursuite des criminels. Les juges de paix ne sont plus que des auxiliaires de ce représentant de l’État auquel ils doivent se soumettre. C’est aussi lui qui décide d’associer le juge d’instruction à ces démarches. Le jury d’accusation n’étant pas systématiquement saisi. Ce texte de l’an IX marque un retour au système antérieur aux réformes révolutionnaires.
Une rédaction chaotique
Car les lois révolutionnaires ont très rapidement montré leurs limites. La justice appartenait pleinement, à travers les juges de paix et les membres des jurys, à des non juristes, élus du peuple, certes, mais bien souvent incompétents. Bien plus, dès les débuts du Consulat, Bonaparte reprochera au système criminel sa douceur et les dysfonctionnements liés au recrutement de son personnel. Il est donc rapidement décidé de rédiger un code criminel, correctionnel et de police unique, traitant de la procédure mais aussi du fonds du droit pénal. Comme ses devanciers, le Code d’instruction criminelle va suivre le processus classique des codifications consulaires et impériales. Un arrêté du 7 germinal an IX installe une commission composée de Vieillard, Target, Oudart, Treilhard et Blondel, chargée d’élaborer un projet de Code pénal global.
Le travail de la commission est effectué en quelques mois et un vaste projet de 1 169 articles est présenté en messidor an IX. Il reprend le système issu du texte de pluviôse an IX, maintenant notamment le principe du jugement par les jurés d’un jury. Mais une consultation auprès des magistrats va considérablement ralentir le processus de codification. Les membres de la Cour de cassation, le Grand Juge ministre de la Justice, les tribunaux d’appel et les tribunaux criminels sont amenés à se prononcer sur cette réforme. Des débats passionnés s’en suivent, révélant l’aversion des magistrats pour les jurés auxquels ils reprochent générosité, indulgence ou timidité qui dans tous les cas portent atteinte à l’efficacité de la justice.
Bon nombre de juristes, et non des moindres, tels Siméon ou Portalis, envisagent d’ailleurs à demi-mots la reprise du système de l’ordonnance de 1670 auquel seraient adjoint les principes du conseil des accusés et de la publicité des débats. L’examen du projet par la section de la législation du Conseil d’État, prenant en considération les remarques issues de la consultation des magistrats, prend de ce fait beaucoup de temps, de mai à décembre 1804. L’impossibilité d’obtenir un véritable consensus, sur la question des jurys notamment, conduit à la suspension des travaux.
Napoléon décide alors de distinguer procédure criminelle et code pénal dans deux textes distincts. Les travaux sur le premier ne reprennent qu’en janvier 1808.
Ils aboutissent péniblement à l’adoption par le Corps législatif du Code d’instruction criminelle par deux lois en novembre et décembre 1808.
Les grands principes du Code de 1808
Bien que répondant à des objectifs clairement fixés par Bonaparte dès les débuts du Consulat (instauration d’un système plus autoritaire et efficace dans la répression, et de ce fait construction très politique) le Code d’instruction criminelle constitue une heureuse synthèse dans l’ensemble entre les principes de l’Ancien droit et ceux inspirés par la période révolutionnaire. Il est donc une oeuvre de transaction à la stabilité remarquable. Il fonde la procédure pénale moderne sous de nombreux points.
Le Code est tout d’abord un Code institutionnel qui réorganise notamment les prisons, aspect de la réforme bien souvent oublié, mais aussi certains tribunaux.
La réforme des prisons avait débuté dès le commencement du Consulat, avec un texte de 1801 créant des prisons centrales interdépartementales, destinées entre autres à accueillir les prisonniers coupables de crimes. En même temps, un arrêté de Chaptal datant de la même année réorganise la vie quotidienne des prisonniers, améliorant leur ordinaire par la hausse des rations journalières et le développement de mesures de confort comme le chauffage de certaines cellules. A cela s’ajoute la promotion du travail des prisonniers destinée à leur fournir des revenus, destinés eux aussi à cette amélioration de l’ordinaire. Le Code de 1808 poursuit cette œuvre. Il sera repris par un arrêté de Montalivet du 20 octobre 1810 consacré à l’installation des prisons. Il prévoit l’installation dans chaque arrondissement, auprès du tribunal d’instance, d’une maison d’arrêt pour y retenir les prévenus, et pour les cours d’assises, d’une maison de justice. Leur but est de tenir séparés condamnés et prévenus ; les prisons du début du XIXe siècle sont en effet dans un état déplorable, mélangeant prévenus et condamnés dans une promiscuité et une insalubrité dramatiques. Ces établissements sont directement placés sous le contrôle des préfets, chargés de s’assurer de leur bon fonctionnement, de leur hygiène et de leur sécurité et contraints de ce fait de les visiter au moins une fois par an. Le personnel de ces établissements est d’ailleurs nommé par eux. Le Code de 1808 lance ainsi le principe de départementalisation des établissements pénitentiaires qui en annonce une meilleure gestion. Le contrôle des détenus est lui-même poussé, de façon notamment à veiller à contrer tout ce qui pourrait faire penser à une détention arbitraire ; les incarcérations se font sur mandat express du juge d’instruction ou du président de cour d’assise. Le juge d’instruction doit aussi visiter mensuellement les prévenus et le président de cour d’assise est soumis aux mêmes obligations à chaque session de son tribunal. Le transfert de la charge budgétaire des détenus à l’échelon local et la rationalisation de l’incarcération sont réalisés en faisant des centrales des maisons de forces où les détenus sont amenés à travailler. Le crime est ainsi bien voué à l’industrie. Mais elle ne parvient pas à éradiquer les dépôts de mendicité dont il est même question, à la fin de l’Empire, de relancer les constructions. Elles n’ont surtout pas remis en cause l’existence du bagne ou des prisons d’État.

À côté des réformes humanistes des prisons, le Code de 1808 conforte le principe des tribunaux spéciaux, installant définitivement une des pratiques les plus controversées du système pénal napoléonien. La loi du 18 pluviôse an IX avait instauré des tribunaux spéciaux destinés à réprimer le vagabondage, ainsi que les crimes et délits des vagabonds, l’évasion des criminels et les rassemblements séditieux. Situés dans le grand ouest, ils étaient censés être éphémères et mis en place dans les seuls cas où le Gouvernement le jugerait nécessaire. Mais l’exception qui les caractérise est l’absence de jury de jugement en leur sein au profit de juges professionnels assistés de militaires. Par la suite, la création de tribunaux spéciaux est aussi envisagée par la loi du 23 floréal an X pour juger des crimes de contrefaçon et de faux en écriture publique, là encore avec une composition dérogatoire du droit commun. L’existence de ces tribunaux d’exception est renforcée par le sénatus-consulte du 27 février 1804 qui permettra au Gouvernement, lorsqu’il le juge nécessaire de suspendre les fonctions des jurys dans les départements où il le juge nécessaire. Le Code de 1808 ne créera donc rien, mais, bien plus grave, institutionnalisera le principe de justice d’exception et avec elle les risques d’arbitraire qu’elle entraîne. La présence de militaires au sein de tribunaux compétents pour juger des civils pour d’autres faits que des crimes de guerre est absolument contraire au principe de fonctionnement de la justice issue de la Révolution qui, sans parler d’une véritable séparation du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs, car il n’était pas reconnu comme tel, aspirait à un fonctionnement au moins autonome de celui-ci. En 1808, les tribunaux spéciaux deviennent les cours criminelles spéciales et deviennent permanents. La loi du 20 avril 1810 pérennisera cette institution en procédant à sa réorganisation.
Mais la réforme de la procédure criminelle de 1808 est surtout l’acte de mort des jurys. La réaction aux dysfonctionnements des jurys a déjà été évoquée. Dès les débuts du Consulat, la défiance du pouvoir envers eux entraîne un accroissement du contrôle de leur composition par le pouvoir exécutif, la disparition de leur capacité à auditionner les témoins au moment de la mise en accusation et parfois la décriminalisation de certains actes afin que ceux-ci soient jugés par des tribunaux composés de professionnels et non de jurés non professionnels. Le Code d’instruction criminelle de 1808 achève cette mise à mort. Il supprime définitivement les jurys d’accusation et transfert leurs compétences à une chambre particulière de la cour d’appel, la chambre de mise en accusation, qui se prononce après une instruction secrète et écrite des affaires. Les magistrats sont à nouveau maîtres de l’accusation et participent ainsi à la confortation du principe d’action publique en matière pénale. En ce qui concerne la juridiction de jugement, la loi du 9 décembre 1808 qui contient le titre II du livre II du Code d’instruction criminelle, si elle maintient le principe du jugement des crimes par un jury populaire, entoure son fonctionnement de garanties particulières, notamment quant au choix des jurés le composant. Les préfets établissent une liste de jurés sélectionnés au sein des collèges électoraux, composée d’élites locales, et réduite par le président de la cour d’assises au sein de laquelle les douze membres du jury sont désignés lorsque cela est nécessaire. Les débats sont alors oraux, publics et contradictoires, l’accusé étant assisté d’un avocat. Ils aboutissent au prononcé de la culpabilité par le jury, les peines étant fixées par des magistrats professionnels.

Le système tel qu’il est fondé en 1808 est sensiblement le même que celui que connaît actuellement la France. Car si les tribunaux d’exception ont disparu depuis longtemps, le procès criminel répond aux exigences posées sous l’Empire, s’appuyant sur certains principes qui, aujourd’hui encore, sont considérés comme des piliers de la justice pénale. C’est en effet le Code 1808 qui pose le principe de distinction des crimes, délits et contraventions justifiant l’adaptation des techniques de jugement à chaque type d’infraction pénale, d’atteinte à la loi. C’est aussi lui qui pose la distinction entre prescription de l’action publique et prescription de la peine, posant ainsi les bases d’un système judiciaire soucieux de l’apaisement social. Et étrangement, c’est enfin lui qui met en avant la nécessité de développer la procédure de réhabilitation, attribuant cette compétence au ministre de la justice.
Étonnant système donc que celui du Code d’instruction criminelle qui pose les bases d’un système judiciaire plus que moderne en conciliant précédent monarchique et théorie révolutionnaire, mais aussi en confortant l’Empereur dans une vision autoritaire de la procédure criminelle. Il n’empêche qu’à bien des égards, annonçant en cela le Code pénal de 1810, le Code d’instruction criminelle est l’une des réussites majeures du système consulaire et impérial.
Mise à jour : mai 2022