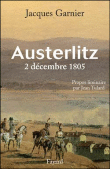Comment lire la bataille d'Austerlitz avec notre regard actuel ?
Napoléon a tout fait pour présenter à la postérité une bataille idéale. Il a souhaité montrer, dans ses relations, dès le 30e bulletin, le mode de lecture qui devait être adopté pour Austerlitz. Déjà avec Marengo, il souhaitait être le seul vainqueur. La cavalerie de Kellermann et l'artillerie de Marmont, l'infanterie de Desaix ne devaient pas avoir dérogé au « système », elles n'avaient fait qu'accompagner le mouvement général. Cinq ans plus tard, le général devenu empereur sait que les conditions sont différentes, qu'il est bien le seul vainqueur, mais il veut faire de sa bataille un « exemple », où tout est « prévu », comme « rêvé ». La référence aux monarques d'Ancien Régime est évidente. Le roi, on le sait, était infaillible. Austerlitz doit devenir la victoire de l'omniscience et de la prévision totale. Or, comme certains rapports de maréchaux copient eux-mêmes ce 30e bulletin, on se trouve confronté à une difficulté importante si l'on cherche à effectuer une exégèse efficace.
Quels sont les principaux ouvrages et les sources dont dispose l'historien pour travailler, pour comprendre les causes, les faits et leurs conséquences ? Pour redécouvrir la réalité ?
Les rapports des chefs de corps sont indispensables. Davout, intellectuellement honnête, rend compte de la bataille telle qu'il l'a vécue. À ce point que Napoléon lui demande d'en « rajouter » un peu. En revanche, Soult s'inspire beaucoup du bulletin. Pour ce qui concerne la campagne, on dispose de la correspondance de l'Empereur : or, pour la journée du 2 décembre, aucun ordre écrit n'a été conservé. Ont-ils été simplement transmis oralement ? Le dernier ordre écrit dont nous disposons est celui des dispositions générales, dicté le 1er décembre à 20 h 30. Les mémoires s'avèrent d'un précieux secours, mais en gardant à l'esprit, une nouvelle fois, que leurs auteurs ont gardé trace de ce fameux 30e bulletin au moment de coucher sur le papier leurs « souvenirs » sur la bataille, sans qu'ils en soient tout à fait conscients. C'est notamment le cas de Ségur. On dispose aussi des commentaires de Napoléon sur la relation de Koutousov, de Soult (mais s'agit-il de lui ?) sur celle de Stutterheim. Or, dans le premier cas, l'Empereur souhaite valoriser son action personnelle, dans le second, le maréchal souhaite être « conforme au bulletin », mais aussi valoriser son action. Outre ces relations de responsables russe et autrichien, le récit de Danilewski, destiné au tsar et qui est le document « officiel » du côté russe. Toute proportion gardée, il s'agit quelque peu de l'équivalent de la relation de Berthier pour les Français. De tout cela, il faut savoir prendre et laisser. Et sans doute relire plus attentivement le récit de Tranchant de la Verne, rédigé en 1809, très sérieux quoique lui aussi « relation officielle » mais établi à partir des travaux honnêtes du général Blin.
Votre ouvrage révèle un certain nombre de découvertes ? Quelle est celle que vous considérez comme la plus importante ?
Il faut bien se rendre compte que Napoléon, arrivé à Brünn, ne sait absolument pas encore de quelle manière il va conduire cette bataille qu'il espère tant. Il est toujours facile d'affirmer aujourd'hui qu'il attira l'ennemi en affaiblissant sa droite, mais à ce moment-là, Napoléon a surtout pensé à concentrer son armée. Savary l'affirme : le 1er décembre, Napoléon se tient prêt à toutes les éventualités, à diriger une bataille offensive ou défensive en fonction des informations dont il disposera. Les Russes marchent sur la route d'Olmütz à Brünn en ligne directe jusqu'au 28 novembre au soir. Jusqu'au 29 novembre, trois jours avant la bataille, Napoléon pense donc qu'ils l'attaqueront de front. C'est pour cette raison qu'il fait fortifier le Santon, avec 18 pièces d'artillerie et tout un régiment, alors que ce point s'avèrera finalement inutile au cours de la bataille. À aucun moment, il n'envisage d'affaiblir sa droite dans la mesure où son armée, à cet instant, ne présente pas un front aligné, mais forme un triangle de cinq kilomètres de côté. Même Davout, qui formera la droite de la ligne de bataille au matin du 2 décembre, avait pour mission de se rendre à Brünn pour procéder à la concentration de l'armée. Bien plus, après l'occupation du plateau de Pratzen par les alliés, après avoir pourtant dit « l'ennemi y restera longtemps s'il attend que j'aille l'en déloger », il organise, par les dispositions de 20 h 30, une bataille offensive, « une marche en avant par échelons, l'aile droite en avant ». Il semble donc bien qu'à ce moment, il pense que toutes ses manoeuvres psychologico-diplomatiques pour faire croire à sa faiblesse et inciter l'ennemi à l'attaquer ont avorté, au moins partiellement. Où est « l'affaiblissement de sa droite », dans tout cela ? C'est dans la nuit seulement qu'il reviendra à un système de bataille beaucoup plus manoeuvrant, celui qui a sa préférence. On ne dit pas assez que la stratégie et la tactique de Napoléon sont conduites en réponse à la situation du moment.
La bataille était-elle réellement inévitable ?
On affirme que Napoléon aurait rendu la bataille inévitable en montrant des signes de faiblesse, et cela est vrai. Mais il est toujours délicat de faire croire à l'ennemi que l'on est dans une mauvaise passe et continuer d'affirmer le contraire à ses propres troupes. Le rôle est difficile à jouer. N'est pas toujours dupe celui que l'on imagine. La mission de Savary auprès du tsar, lorsqu'il demande un armistice, est facile à intégrer dans ce jeu, puisqu'il ne concerne que l'ennemi. Mais dire à Lannes que l'armée va reculer, laisser les postes de Wischau se faire battre sans leur apporter d'aide, le message est assez difficile à « faire passer » vis-à-vis des troupes.
Un fait qui a été quelque peu oublié dans la préparation napoléonienne de la bataille est le mouvement du corps de Soult entre le 20 et le 30 novembre : le 4e corps, lorsqu'il est envoyé dans la région d'Austerlitz n'a que le rôle d'un corps de couverture et d'observation. Il le remplit parfaitement. En plus, lorsque, sous la menace de l'avance de l'armée ennemie, Napoléon le fait se replier – ce n'est en aucune manière la Grande Armée qui « abandonne le plateau de Pratzen » – il procède à une reconnaissance « grandeur nature » des chemins que pourra employer l'ennemi. Par cette simulation, connaissant les difficultés rencontrées par les divisions Vandamme et Saint-Hilaire, le jour de la bataille, l'Empereur dispose d'un avantage considérable sur ses adversaires. Ce n'est pas le moindre de ses talents.
Parmi les chefs de corps, quels sont les grands oubliés de la victoire ?
Deux sont particulièrement intéressants. Soult, tout d'abord, qui connaît bien le champ de bataille à la suite de la manoeuvre que nous venons de voir. Napoléon aurait pu envoyer un « général d'avant-garde » (comme Lannes) mais avec Soult il souhaite confier cette mission à quelqu'un de moins combatif et de plus réfléchi. Toutes les reconnaissances faites dans les deux journées qui précèdent la bataille seront ensuite effectuées par l'Empereur en compagnie du maréchal Soult, bien que, il faut le reconnaître, ce dernier n'ait pas immédiatement compris le côté « idéal » de ce champ de bataille. N'avait-il pas écrit, à Napoléon, le 24 novembre, alors qu'il occupait la région, « le pays est tellement décousu que la moitié des régiments devrait être de service pour garder l'autre moitié » ?
L'autre grand homme de la journée est bien sûr Davout, qui par la marche de 112 km en 44 heures de ses hommes, réalise avec eux un exploit. Le jour de la bataille, il fera preuve d'intelligence en ne marchant pas comme l'exigent ses ordres sur Sokolnitz mais sur Telnitz parce que c'est là que l'exige le combat : il fait preuve d'initiative et il est le seul à le faire à bon escient.
Un troisième, fidèle à sa réputation, doit être cité, en contraste avec les deux premiers : Bernadotte. Trop lent le jour de la bataille, peu actif le lendemain dans la poursuite : il se montre tel qu'il sera l'année suivante à Auerstadt.
Quel régiment a été décisif ?
Le grand-duc Constantin, frère du tsar, qui commandait la Garde, dira à Tilsit à un proche de Davout : « La bataille d'Austerlitz a été gagnée par le 48e d'infanterie ». En d'autres termes et plus largement : par les hommes de Friant. Si tel est le cas, c'est parce que le verrou n'a pas sauté. A contrario, le 4e de ligne attaqué entre midi et treize heures et commandé par le major Bigarré (mais, en titre, par le colonel Joseph Bonaparte, resté à Paris) se « distingua » par la perte de son drapeau.
Une faille existait-elle dans le dispositif napoléonien ?
À la différence des batailles d'Iéna et Wagram, pendant lesquelles Napoléon dispose des troupes au fur et à mesure qu'elles rallient et où il dirige entièrement la manoeuvre, curieusement, à Austerlitz, il donne ses ordres le matin à l'aube et semble laisser à sa gauche et à sa droite la bride sur le cou. En particulier sa gauche, formée par Lannes et Murat. Vers 15 heures, Lannes s'arrête d'ailleurs parce qu'il ne connaît pas la situation au sud. Davout dispose de la brigade Merle de la division Legrand mais il oeuvre, comme diraient aujourd'hui les sportifs, « le nez dans le guidon ». Cela explique que la division Levasseur reste inoccupée.
Étonnamment, on retiendra que le seul commandement donné en personne par Napoléon est l'envoi de la Garde à cheval pour défendre le 4e de ligne. L'Empereur suit son armée d'abord de son poste d'observation du Zuran, où il se trouve au début des combats, mais d'où il ne peut voir ce qui se passe à Telnitz et Sokolnitz, puis il suit l'avance de son centre en venant se placer sur la colline du Stare Vinohrady, enfin près de la chapelle Saint Antoine d'où il domine la région des étangs. Mais il sait bien que c'est là que se trouve la clef de sa manoeuvre.
Quel est le moment-clé de la bataille ?
Il faut distinguer le moment réel de l'instant « symbolique ». Le fait le plus important est indéniablement la prise du Pratzen par les hommes de Soult dans la matinée. Thiébault arrive dans le village à 9 heures. Vers 11 heures, on se trouve au sommet du plateau, tandis que les Russes de Buxhöwden sont en bas, vers Telnitz et Sokolnitz, donc déjà pris en tenaille. Auparavant, à 9 heures, Telnitz étant vide, la 1re colonne de Doctorov pouvait passer et rendre les choses délicates pour les Français : par chance, les trois colonnes devaient, selon les ordres de Weyrother, s'aligner l'une sur l'autre avant de continuer leur percée. Le temps qu'ils effectuent leur manoeuvre, le front français était reconstitué. À 11 heures, les défilés de Telnitz et Sokolnitz pouvaient à nouveau être passés par les Russes, mais, à ce moment, Langeron et les chefs de corps russes apprennent que leur position va vite devenir intenable puisque les Français arrivent sur leurs arrières. La manifestation « symbolique », en revanche, correspond à l'instant, vers 13 heures, où le 4e de ligne et le 24e léger de Vandamme formant la gauche de Soult, en difficulté, sont soutenus par les grenadiers, les chasseurs et les mamelouks de la Garde envoyés par l'Empereur. Cette attaque de la dernière chance des chevaliers-gardes russes, repoussée par la Garde Impériale, constitue une victoire certaine : c'est le moment que choisit Berthier pour avertir de la victoire Talleyrand alors à Vienne. Mais, même sans ce choc des deux gardes impériales, la victoire était acquise.
N'existait-il pas d'autres solutions, une autre conduite à tenir pour les jours qui suivirent ?
En 1806, contre les Prussiens, Napoléon choisira d'annihiler les forces ennemies. À Austerlitz en revanche, il a nourri quelque inquiétude sur ses chances de succès : 72 000 hommes loin de leurs bases opposés aux possibles 100 000 adversaires et victorieux, constitue un exploit. Voir les Russes s'enfuir et les Autrichiens prêts à traiter lui suffit. Il s'en contente. Et n'oublions pas que les Prussiens, bien que recherchant la paix, ne sont pas loin et que les troupes « italiennes » du prince Charles peuvent être réunies à celles du prince Jean. Napoléon a eu sa victoire, une victoire complète. Il s'en contente, tout simplement.
Comment expliquer la place de choix occupée par Austerlitz dans l'imaginaire collectif et plus précisément dans l'armée française ?
L'anniversaire du sacre, la double prime aux soldats de la campagne de 1805 qui montre l'importance politique accordée, les objets et monuments fabriqués : tout indique qu'Austerlitz a un rôle politique important à jouer. Les soldats de la République sont toujours là, leurs uniformes en témoignent : c'est aussi la victoire de la Révolution. Napoléon cherche aussi à se faire traiter en empereur, non pas en « chef du gouvernement français » comme le tsar le lui a signifié par sa lettre. Tout contribue à une grande mise en scène. Plus personnellement, depuis mon adolescence, étant moi-même un gros marcheur, je vouais une admiration pour ces soldats qui avec leurs modestes chaussures avalaient les kilomètres, jour après jour, et participaient aux combats. La division Friant fit en deux jours près de 120 km pour gagner Raygern, elle combattit toute la journée du 2 décembre sous une pluie mêlée de neige – je me suis rendu sur place à la même période de l'année et les conditions sont difficiles – et elle commença dès le 3 décembre la poursuite. C'est là le véritable héroïsme. Bien se battre dans le moment de la fureur peut se comprendre, mais marcher jusqu'à la limite de l'évanouissement pour se rendre sur le lieu de la future bataille démontre un courage extraordinaire.
Cette interview est parue dans la Revue du Souvenir Napoléonien, en novembre 2005.