Marie de Bruchard : C’est votre deuxième biographie sur un grand personnage historique et controversé, après Talleyrand (Talleyrand, Le prince immobile, Fayard, 2003). Fouché était-il pour vous un sujet évident, dans une suite logique, à scruter ?
Emmanuel de Waresquiel : Il y a certainement cette idée derrière cette double biographie du « vice » et du « crime » comme dit Chateaubriand, d’un diptyque. Talleyrand et Fouché, chacun à leur manière et dans leurs domaines respectifs, sont des catalyseurs, des passages obligés vers la modernité. Ils réfléchissent peut-être mieux que d’autres leur époque et nous en facilite la lecture. Fouché par exemple, dans sa pensée comme dans ses actes, croise des thèmes essentiels à la compréhension de la Révolution comme de la construction de l’État. Qu’est-ce que le peuple, la centralité, l’arbitraire et la violence, en quoi la surveillance, le contrôle et le secret sont-ils constitutifs de la formation de l’État moderne comme d’une société organisée sur le principe de l’égalité ? Fouché a été celui et l’un des rares qui ont tout à la fois contribué à la destruction d’un ordre ancien et à la construction d’un ordre nouveau. Avec lui, on est au cœur de ce paradoxe qui traverse toute notre époque contemporaine, celui de la liberté, de l’ordre et du désordre. Il est l’homme de l’opinion autant que celui de sa manipulation. À l’aube de nos modernes sociétés démocratiques, il en invente déjà les contre poids, les garde-fous si j’ose dire : la police, le passeport, la statistique, le renseignement. Ceci étant dit, il est d’une approche plus difficile que celle de Talleyrand, plus dissimulé surtout, ayant systématiquement détruit ses traces et brouillé les pistes en grand policier qu’il était, alors que Talleyrand l’avait fait, je dirais, en amateur ! Il m’étais au départ plus étranger – sinon étrange – que Talleyrand, par ses origines sociales, par l’exercice de la violence qu’il a pratiqué sans états d’âme. Autre difficulté. Avec lui, il me fallait « entrer » en révolution, une période sur laquelle je n’avais jamais véritablement travaillé, surtout sa partie terroriste, celle de 1793-1794. Cela a été passionnant.

M. B. : « La biographie est un exercice paradoxal pour un historien, l’alliance du chaud et du froid, une méthodologie extrêmement précise de l’historien dans l’utilisation des sources et dans leur organisation, une mise en scène du sujet et du personnage même, qui est là la partie littéraire de l’affaire », nous disiez-vous en 2003, sur Talleyrand. Le ministre de la Police de Napoléon a voulu effacer toutes traces compromettantes, en brûlant ses papiers. Comment votre travail d’historien s’est-il déroulé sur les archives pour extraire le portrait d’un homme qui s’est rendu imperméable ?
E. W. : Le récit biographie est une illusion car il doit montrer le moins possible du travail qui le constitue : la question de la position du biographe face à son personnage, la définition de ses sources et de leur champ, leur recherche, leur classement, leur analyse selon leur nature, en fonction aussi du temps dans lequel elles se situent par rapport à l’événement auquel elles se rapportent, l’étude enfin du « sujet » qui les a produit. Le travail de l’historien est un travail constant sur le temps, le sien et celui de son personnage, le passé, le présent et le futur, l’histoire et la mémoire, c’est une construction, comme si l’on démontait et que l’on remontait sans cesse le temps. Nous sommes un peu, au fond, les mécaniciens du temps, caché au cœur de l’un de ses paradoxes les plus fascinants et les plus énigmatiques : tout passe et rien ne s’oublie ; rien ne passe et tout s’oublie. Avec tout cela, le biographe est tenu de préserver coûte que coûte son récit, avec ses enchaînements logiques, ses lenteurs et ses accélérations. Raconter une vie, c’est faire des choix, ménager un certain suspense, mettre l’accent sur tel moment plutôt que sur tel autre, et croiser ce dernier avec tel thème qui l’éclaire. Le biographe est tenu, dans un même récit, de donner à entendre les voix de ses personnages et de les analyser. Il est à la fois le narrateur qui raconte la scène et le cœur antique – en référence à ce dispositif bien connu de la tragédie grecque – qui la commente.
De toutes les écritures de l’histoire, cette écriture-là est certainement la plus difficile et la plus complexe. Mais encore une fois, cela ne doit pas se voir. Elle tient un peu de la quadrature du cercle, du côté de la littérature et du côté de la méthode. Car heureusement les sources résistent et l’historien est tenu d’en user avec toute l’honnêteté, la modestie, mais disons-le aussi, l’intelligence critique qui doivent être les siennes. Les trouvailles, les sources inédites ne lui sont pas forcément nécessaires. Il suffit parfois et bien souvent de relire attentivement celles qui ont déjà été utilisées par d’autres. Mais encore faut-il y retourner et fréquenter les fonds d’archives ! Un « inédit » peut-être parfaitement inutile. Il peut tout autant contribuer à faire évoluer la vision que l’on a de son « sujet ». Dans le cas de mon Fouché, la découverte de sa correspondance familiale, avec sa première femme Bonne-Jeanne Coiquaud épousée en 1792 et avec ses enfants, a été déterminante, notamment en ce qui concerne l’approche psychologique que j’ai pu avoir de lui.
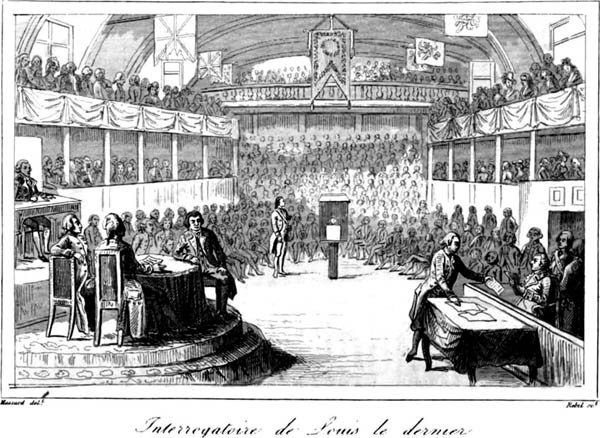
M. B. : Dans votre ouvrage, vous écrivez tour à tour « de ces longues années de l’Oratoire, il garde des traits qui ne le quitteront jamais et feront de lui tout à la fois le grand policier et le futur homme d’État : le goût de l’ordre et du détail, de la discipline et de la clôture, de la formation et de l’éducation des esprits. »et « Cet homme qui s’apprête à voter la mort du roi est inquiétant, silencieux, dissimulé. il a déjà l’aura maléfique de ceux qui ont un secret. il ne changera plus. » Quel contraste ! Fouché est-il si double ?
E. W. : Oui, l’un de mes écrivains préféré Jorge Luis Borges disait de ses personnages qu’ils sont doubles et que le vrai, c’est toujours l’autre ! Eh bien Fouché est de ceux-là. Ce qui le caractérise, c’est bien l’ambivalence. Le chagrin de soi, le désamour et en même temps, la passion et le pouvoir, l’homme sensible et tout à la fois le grand cynique absolument dépourvu d’affects, mais aussi le frondeur et l’homme d’ordre, le conspirateur, l’aventurier et l’homme d’État, capable tout à la fois de violence et de modération puisque, comme il le disait lui-même, « la politique est la morale des circonstances ». Fouché est de ceux qui ont été en guerre permanente contre eux-mêmes, et aussi dans son cas contre la maladie, la tuberculose qui finira par le terrasser. Il va trouver dans l’ambition et dans le pouvoir à la faveur de la Révolution, une sorte d’exutoire à la solitude et au dégoût de soi. C’est un laid. C’est également un homme qui dans son enfance et par sa formation oratorienne baigne dans le silence et dans la mort. La mort d’ailleurs l’accompagne toute sa vie. Il perd son père et plusieurs de ses frères et sœurs alors qu’il n’a pas dix ans. Il ne dira jamais rien de sa mère. Il donne la mort et en même temps il y échappe à plusieurs reprises sous la Révolution. Il est de ces personnages qui ont une évidente dimension tragique, jusque dans son exil après 1815, à Trieste, au fin fond de l’Adriatique.

M. B. : Après sept ans à vous pencher sur cette destinée, pouvez-vous nous dire quelle a été votre plus grande surprise sur la vie de cet homme ?
E. W. : Il y en a eu beaucoup. D’abord j’ai découvert dans les archives de Nantes que son père était capitaine de navire négrier. L’esclavage est à l’origine de la fortune des Fouché qui, par ailleurs, possédaient une plantation à Saint-Domingue. Cela en dit long sur la nature du personnage quand on sait qu’il présidera à Lyon sous la Terreur à l’une des fêtes les plus spectaculaires consacrée à la liberté des noirs et que par ailleurs il n’abandonnera jamais les réseaux coloniaux. Le « lobby » noir et des îles joue un très grand rôle dans sa vie, pendant et bien après la Révolution. Ensuite, ses réseaux d’affaires dans lesquelles il se lance dès 1795, alors qu’il est loin d’être dépourvu de tout comme il le prétend dans ses mémoires et comme ses biographes le répèteront. D’autres choses encore, son jacobinisme avant l’heure, bien avant son vote de la mort du roi, son adhésion au consulat à vie dès 1802 contrairement à ce qui a été dit, etc., etc. Mais le plus important n’est pas là. Fouché a eu beau servir tous les régimes, il n’en est pas un opportuniste pour autant, un pragmatique sûrement, manoeuvrier et machiavélique sans doute, mais il restera toute sa vie fidèle à la Révolution, ses principes et ses acquis, qui le constituent littéralement, même en 1815. C’est cela la grande leçon. Pour cela, il fallait aller aux textes, déjà publiés, parfois inédits, car comme beaucoup d’hommes d’État de cette stature, il a été à la fois un théoricien et un acteur de la politique. N’oublions pas qu’il sort de dix années d’enseignement à l’Oratoire ! Ce qu’il dit sur la nécessaire mort du roi, sur la « Révolution totale », sur la Terreur, sur la force de l’opinion, sa liberté et son contrôle, sur l’invisibilité de la police est toujours passionnant et surprenant. Il a été fidèle à la Révolution et tout autant aux hommes qui l’ont servie. La découverte que j’ai pu faire des comptes secrets du ministère de la Police, alimentés par la caisse des jeux, dans lesquels sont indiqué les noms des principaux agents du ministère, dit tout des permanences révolutionnaires, jusque sous l’Empire.

M. B. : Dans son parcours atypique, sous ses régimes différents, quelle serait sa plus grande erreur et quelle serait sa plus grande réussite, selon vous ?
E. W. : Avoir sauvé Paris le 3 juillet 1815 et avoir eu, au même moment et pour la première fois, trop confiance en lui en pensant que son serment de ministre à Louis XVIII le laverait, au moins politiquement, de son régicide. Cela a été sa grande illusion et il en est, d’une certaine manière, mort.
M. B. : Y a-t-il un héritage de la pensée de Fouché aujourd’hui, par exemple dans sa conception de l’Etat ou de la police ?
E. W. : Oui, je suis frappé du poids des héritages de cet homme. Cela en est même extraordinaire. D’abord l’organisation des pouvoirs d’État, le rattachement de l’État à la nation par le régicide, la centralité jacobine, le contrôle de la mobilité, la prévention et la surveillance, l’invention non pas seulement d’une police répressive mais d’une police d’opinion, à l’origine de nos modernes renseignements généraux. L’attention apportée à la formation et à l’éducation des peuples, à l’opinion publique, son attachement à l’égalité beaucoup plus qu’à la liberté, cet imaginaire omniprésent dans lequel nous vivons encore. Fouché est enfin, comme Talleyrand et plus que lui encore, l’inventeur de ce paradoxe moderne. Plus l’homme politique est confronté à l’opinion publique, plus il est amené à inventer les stratégies de l’opacité et du secret. Nous n’en aurons jamais fini avec lui.
Propos recueillis en octobre 2014


